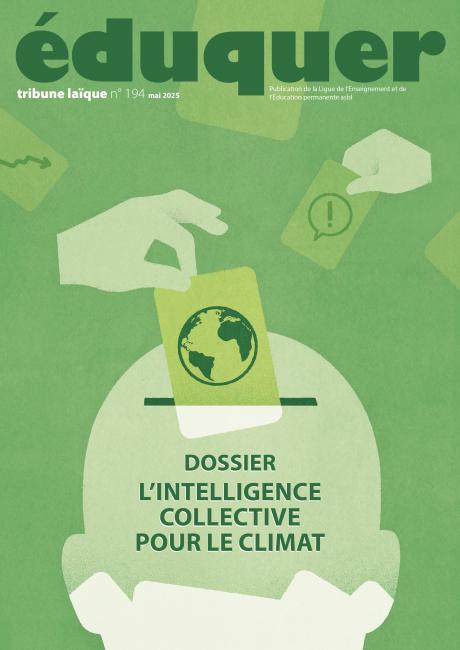L’intelligence collective pour le climat
L’Europe se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. Selon le dernier rapport Copernicus publié en avril dernier, la température a augmenté en Europe de 2,9 °C par rapport à la moyenne préindustrielle. Un chiffre particulièrement interpellant au regard de l’objectif global de l’Accord de Paris qui vise à contenir «bien en dessous» de 2 °C, voire à 1,5 °C, la hausse des températures moyennes au niveau planétaire. Or, «chaque fraction de degré supplémentaire d’augmentation de la température est importante car elle accentue les risques pour nos vies, pour les économies et pour la planète», alerte Celeste Saulo, secrétaire générale de l’Organisation météorologique mondiale.
Fonte des glaciers, acidification des océans, incendies, pluies torrentielles et inondations, ou encore famines et sécheresses: les graves conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes et l’accumulation des records du changement climatique – comme en 2024, l’année la plus chaude jamais enregistrée – ne semblent pourtant plus figurer en première priorité de l’agenda politique mondial. L’éléphant est dans la pièce et peu d’actions collectives d’envergure sont entreprises. Alors qu’en parallèle, chacun et chacune est invité·e à faire sa part et à adopter des écogestes individuels…
Dans ce contexte, des voix militantes s’élèvent – «L’inaction climatique est un crime. L’inaction climatique tue» – et des initiatives non gouvernementales émergent, telle la Fresque du Climat, un atelier d’éducation à l’environnement qui vulgarise les données scientifiques du GIEC et qui connaît un développement exponentiel, partout dans le monde, depuis sa création en 2018.
Quelle est cette initiative émanant de la société civile? Cet outil pédagogique en intelligence collective est-il accessible et adapté à tout public, en particulier pour les jeunes? Et pour agir vers un futur plus durable et plus désirable, suffit-il simplement de comprendre? Tout en risquant de faire reposer sur les seules épaules citoyennes la responsabilité des changements fondamentaux nécessaires à la survie de notre monde, l’impact réel des ateliers collaboratifs sur les changements de comportement, sur la diminution de notre empreinte carbone et sur la réduction globale des gaz à effet de serre est mis en perspective. Au départ de ces ateliers, c’est toute la question de l’éducation au climat dont le monde a besoin qui se pose.
Un dossier réalisé par Marie-Françoise Holemans