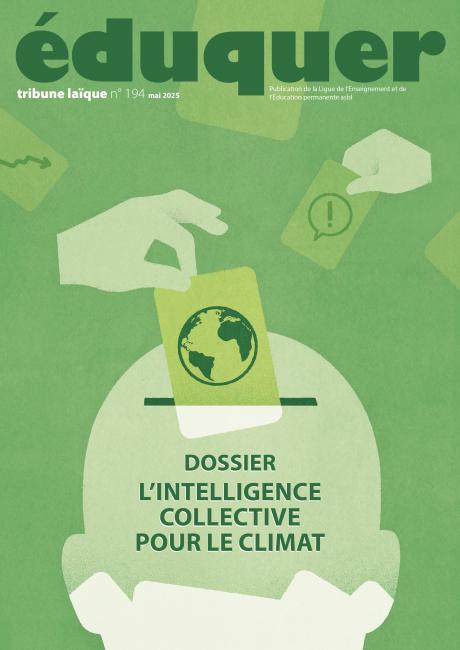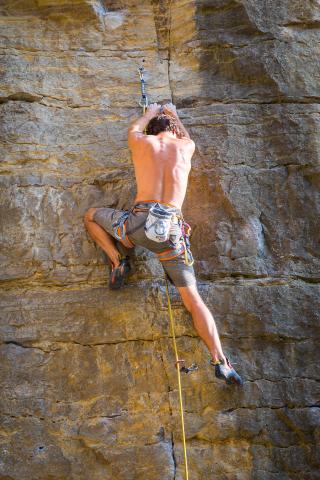De l’école aux parents, adhère-t-on au virtuel?
Jeudi 17 avril 2025

Aksel Kilic et Jean-Paul Payet sont tous deux sociologues, spécialistes en sciences de l'éducation. Ils cosignent le récent ouvrage L'école du like, fruit de leur enquête sur l’usage des applications numériques entre l'école et les familles. Ils décrivent pour Éduquer ce nouveau phénomène qui transforme profondément les relations écoles-parents.

«Chers parents, notre heure d’arrivée à l’école est finalement prévue pour 9h35 ce matin». Ding! Le smartphone de Mariève vibre au petit-déjeuner. Entre deux gorgées de café, elle consulte l’application Smartschool. Cette notification va lui permettre d'organiser l'accueil de son fils Grégoire, de retour d'une semaine en Slovénie et Croatie. Un adolescent épuisé par son voyage de rhéto, qu'elle récupérera tout à l'heure, mais dont elle aura pu suivre les aventures à distance grâce aux clichés partagés par la titulaire. «C'est rassurant et pratique, quand c'est bien utilisé», sourit Mariève en faisant défiler les multiples fonctionnalités de l'application sur son téléphone portable.
ClassDojo, Scolares, Konecto... la liste est aussi longue que les jeux de mots inventés pour connecter les deux univers de l’école et de la famille. Bienvenue dans l'ère de la digitalisation, où les porches d'école se transforment en portails numériques et où les enseignant·es deviennent, parfois malgré eux, des influenceurs et influenceuses du quotidien scolaire. Car loin de convenir à tous les acteurs, ce type de communication soulève de nombreuses questions: droit à l'image, remplacement d'une communication présentielle par une communication virtuelle, ingérence des parents, instantanéité des propos, dérives potentielles, pression supplémentaire sur les profs, etc.
Les sociologues Aksel Kilic et Jean-Paul Payet ont consacré plus d'un an à étudier sept de ces applications. Après avoir interrogé une soixantaine d'acteurs du milieu éducatif, leur verdict est sans appel: ces outils virtuels bouleversent profondément la relation école-familles1 . Alors que le téléphone portable sera officiellement interdit aux élèves dès la prochaine rentrée scolaire, nous avons voulu comprendre comment l'école elle-même utilise ces technologies pour communiquer avec les parents.
Éduquer: Votre ouvrage s’intitule L'école du like. Pourquoi ce titre?
Aksel Kilic: Le titre renvoie à une fonctionnalité emblématique de ces applications de communication entre les écoles et les familles. Lorsqu'un enseignant fait une publication, le parent peut la liker sous forme de pouce, de cœur ou d’étoile, reprenant en partie les codes des réseaux sociaux.
Jean-Paul Payet: C'est un titre volontairement provocateur qui confronte deux mondes a priori très différents: l'école et les réseaux sociaux. Notre enquête vise à documenter les transformations induites par l’utilisation d'outils numériques dans ces relations.
«Ces outils offrent aux parents un accès virtuel à la classe. Ils leur permettent de s’immiscer dans la vie scolaire de leur enfant.»
Éduquer: Comment ce passage au virtuel transforme-t-il la relation école-familles?
A.K.: Ces applications inaugurent une nouvelle ère. Pour les parents, ces outils offrent un accès virtuel à la classe. Nous l’appelons le mythe de la petite souris, qui leur permet de s’immiscer dans la vie scolaire de leur enfant. Pour les enseignants, la communication devient une part importante de leur métier.
J.-P.P.: Ces outils créent de la proximité et égalisent l'accès entre les parents disponibles aux heures d'entrée et de sortie et ceux qui ne peuvent être physiquement présents.
Éduquer: Ces applications réduisent-elles les inégalités sociales?
J.-P.P.: Les applications promeuvent l'idée d'une «communauté» sans différences sociales, ce qui est partiellement vrai. L'équipement en smartphones n'est plus un facteur discriminant. En revanche, communiquer avec l'enseignant exige des compétences sociales davantage présentes chez les classes moyennes ou favorisées. Cela dépend aussi beaucoup de l'approche de l'enseignant. Certaines applications proposent des traductions simultanées, et des enseignants encouragent les parents à écrire même s'ils ne maîtrisent pas bien le français. Il peut s’y développer une forme de connivence autour d'un langage hybride, entre échange formel et emploi d'émojis. Néanmoins, précisons que ces dispositifs ne sont pas magiques. Si certains enseignants en font un usage inclusif, d'autres peuvent perpétuer une communication asymétrique. L'outil offre certaines opportunités, mais ne résout pas miraculeusement la question des inégalités.
Éduquer: Quelles sont les conséquences pour les profs?
A.K.: Les compétences en communication deviennent essentielles au métier d'enseignant. Nos recherches montrent que les parents s’habituent aux publications et qu’ils peuvent ensuite reprocher à un enseignant de ne pas le faire.
Éduquer: Les enseignants semblent privilégier l'extraordinaire à la quotidienneté dans leurs publications...
J.-P.P.: Tout à fait. On retrouve l'aspect esthétique des réseaux sociaux: on publie quelque chose de visuellement attrayant. Rarement une leçon ordinaire. Ce sont plutôt des moments particuliers: sorties, anniversaires, travaux artistiques, projets spéciaux. Cela permet aux enseignants d'obtenir la reconnaissance des parents sur leur travail. En témoignant de l'épanouissement des enfants, les enseignants répondent ainsi à une attente parentale contemporaine.
Éduquer: Vous écrivez que ces applications répondent à de nouveaux besoins. Lesquels?
A.K.: Notamment au besoin des parents de voir leurs enfants heureux et épanouis à l'école. Sur les photos partagées par les enseignants, nous avons remarqué que certains parents scrutent leur enfant pour observer s'il sourit. Il y a également une attente d'enrichissement culturel: l'école doit maintenant proposer des rencontres avec des artistes, des activités variées, des sorties, etc. Les applications rendent l’organisation de ces activités plus tangibles.
Éduquer: Peut-on craindre une dérive vers un rapport consumériste à l'école, avec des «parents clients»?
A.K.: Notre enquête ne nous permet pas d'affirmer cela clairement. Les publications sur ces applications accentuent des pratiques déjà existantes, notamment par le journal de classe. Leur digitalisation les rend plus visibles et plus esthétiques, plus instagrammables. Quant à la question du clientélisme, l'envie que son enfant ait tel enseignant plutôt qu'un autre a toujours existé. Les applications renforcent cette visibilité et peuvent créer une forme de concurrence professionnelle entre l'enseignant très dynamique qui publie beaucoup et celui qui publie peu. Il est également important de comprendre que cette transformation vient souvent «par le bas», sous l'influence de collègues ou de parents, plutôt que par injonction hiérarchique.
Éduquer: Ces outils favorisent-ils une véritable coéducation?
J.-P.P.: Ces applications entretiennent un lien convivial, mais la coéducation impliquerait d'aborder des sujets sensibles que ni les enseignants ni les parents ne souhaitent vraiment discuter. Ces outils correspondent bien à notre époque individualiste où l'on renforce le lien avec l'enseignant de son enfant, sans nécessairement vouloir débattre collectivement de sujets éducatifs.
«Pour les parents, liker est une façon de reconnaître le travail et l'investissement de l'enseignant, créant ainsi un cercle de reconnaissance mutuelle.»
Éduquer: Ces applications modifient-elles aussi la «profession» de parent?
A.K.: Effectivement, c'est une nouvelle tâche qui s'ajoute: vérifier les publications, y réagir. Pour les parents, liker est une façon de reconnaître le travail et l'investissement de l'enseignant, créant ainsi un cercle de reconnaissance mutuelle. Cette nouvelle tâche est le plus souvent assumée par les mères, ce qui ajoute à leur charge mentale.
Éduquer: Comment le personnel enseignant gère-t-il la frontière entre temps professionnel et personnel?
A.K.: Nous avons observé tous les cas de figure. Certains sont constamment sur leur téléphone et vivent cette activité comme une continuité entre temps privé et professionnel. D'autres cadrent davantage, déconnectant les notifications à 17h30 pour ne les retrouver que le lendemain à 8h30.
J.-P.P.: Il y a aussi des différences générationnelles. Les jeunes enseignants sont plus habitués à cette imbrication entre privé et professionnel.
Éduquer: Ces technologies s'ajoutent aux pratiques existantes plutôt que de les remplacer...
A.K.: Pour les enseignants, c'est un travail supplémentaire. Certains publient quotidiennement, d'autres une fois par semaine, d'autres encore uniquement pour les événements exceptionnels. Mais ceux qui publient beaucoup disent tous trouver une satisfaction dans le retour sur leur investissement: voir des parents heureux, confiants, qui reconnaissent leur dynamisme professionnel.
- 1KILIC A. et PAYET J.-P. L’école du like. Les nouvelles relations école-familles à l’ère du virtuel, PUF, 2024, 208 p.