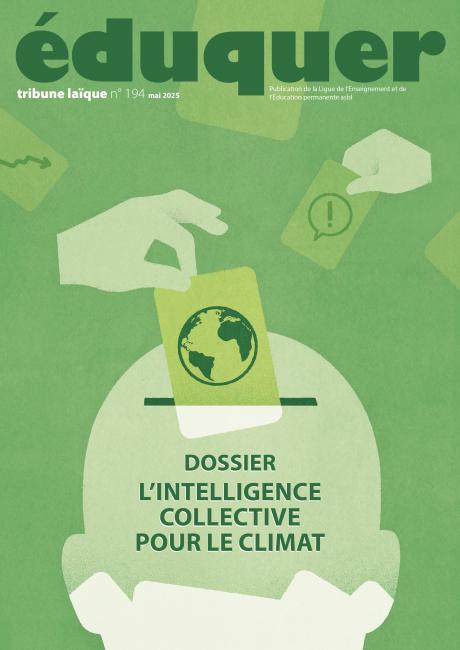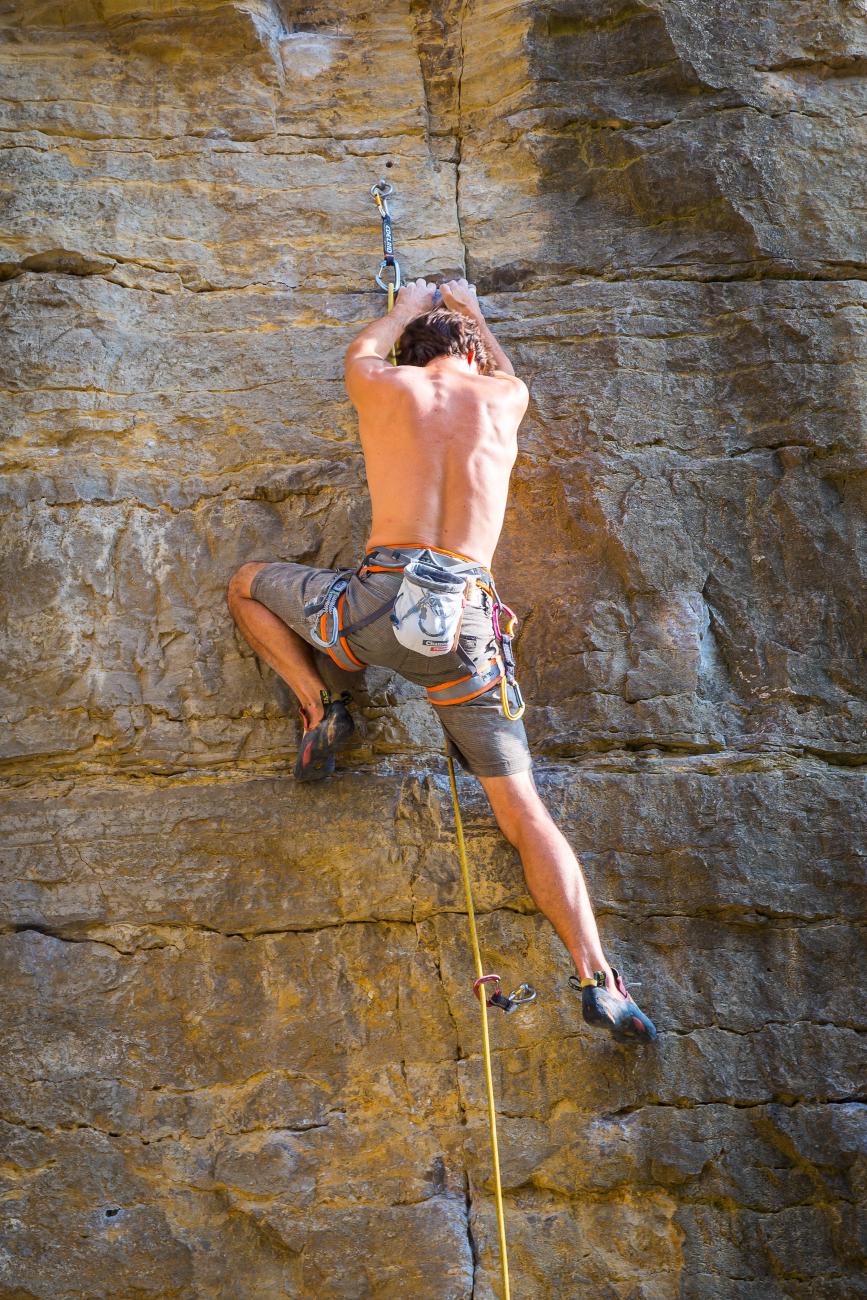
Pourquoi l’être humain a-t-il conçu des machines qui lui ressemblent si peu? Pourquoi les bateaux n’ont-ils pas de palmes comme les canards et pourquoi les voitures n’ont-elles pas de pattes? Mais aussi, comment fonctionnent nos muscles? D’où cette nouvelle interrogation: quelles sont les ressemblances et les différences entre la locomotion des véhicules et celle des animaux?
«Maman les p’tits bateaux qui vont sur l’eau ont-ils des jambes?» Cette chanson enfantine pose une question importante: pourquoi l’être humain a-t-il conçu des machines qui ressemblent si peu au fonctionnement des animaux? Et ceci appelle une question symétrique passionnante: «Maman les p’tits humains ont-ils des moteurs?».
Les voitures n’ont pas de jambes…
Les voitures n’ont pas de jambes, pas plus, bien sûr, que les vélos, les trains, les camions ou les véhicules à chenilles. Les moyens de transport terrestres – à l’exception de certains robots, comme ceux de la firme Boston Dynamics1 – ne possèdent pas de système comparable aux pattes (appuis alternés). Quant à l’avion et au bateau qui se déplacent sur un fluide, ils n’ont besoin que d’une surface lisse. Pourquoi les êtres humains n’ont-ils quasiment jamais mis au point de véhicules avec des «jambes»? Pourquoi le quadrupède mécanique de Star Wars, le TB-TT (Transport Blindé Tout-Terrain), n’a-t-il jamais vu le jour «en vrai»?

La clé réside ici dans la mise au point d’un système de pièce circulaire en rotation autour d’un axe fixe: autrement dit, la roue! Avec des roulements de bonne qualité, la roue présente l’avantage de réduire les frottements de façon extraordinairement efficace, à condition toutefois que le substrat soit assez lisse et pas trop pentu. Ceci nécessite d’investir beaucoup de temps et d’énergie dans la construction de routes, éventuellement de tunnels, lacets, viaducs, etc.
Cette option a finalement toujours été la solution retenue car niveler, creuser, tasser, goudronner se révèle à long terme plus efficace que de concevoir des véhicules quadrupèdes capables de traverser une forêt ou un chaos de rochers. Et au pire, en l’absence de route ou en pente très raide, on recourt à l’usage des jambes: celles des ânes, des lamas ou des porteurs humains. Pas de roues ni de jambes aux bateaux ou aux avions assurément, mais on y retrouve le principe d’une partie tournant autour d’un axe fixe avec les moteurs et les hélices.
… et les animaux n’ont pas de roues
Inversement, il est remarquable que le vivant n’ait pas «inventé» la roue ou, en termes biologiques plus exacts, que l’évolution n’ait pas sélectionné des structures de forme comparable à celle d’une roue. Il semble que cette structure présente de nombreuses exigences incompatibles avec le vivant, notamment l’existence de parties détachées qui ne respectent pas la continuité des tissus vivants: il faut une partie mobile, qui doit tourner autour d’un axe fixe sans y être attachée, et mue par des muscles. Ceci semble poser des problèmes difficiles à résoudre avec des tissus vivants2 : si un muscle fait tourner une roue, il doit y être attaché, et donc s’enrouler autour comme du fil sur une bobine, ce qui ne permet pas de faire beaucoup de tours! De plus, comme on l’a vu plus haut, le jeu n’en vaut pas vraiment la chandelle: la roue ne représente un avantage évolutif qu’en terrain plat et régulier. Or où trouver de telles surfaces sur Terre ? Sur les lacs gelés, les plaines de sel ou de sable: bref, si la roue existait chez le vivant, elle ne serait utile que dans les régions… sans vie3 !
«À la base de l’énergie contenue dans l’alimentation, on trouve toujours une plante transformant l’énergie solaire en énergie chimique.»
Un point commun: l’oxydation d’un carburant
Intéressons-nous maintenant à la source d’énergie des moyens de transport à traction non animale: avion, bateau, train, voiture, camion, principalement. Nous nous apercevons que, à l’exception notable du train à moteur électrique4 qui prend son énergie sous cette forme, tous ces véhicules ont, comme source d’énergie, l’énergie chimique, c’est-à-dire de l’énergie contenue dans la structure d’une certaine substance particulière comme le charbon, l’essence, le diesel, le lithium, etc.
C’est une réaction dite «d’oxydation» (une famille de réactions chimiques comprenant notamment les combustions) de ces substances qui fournit l’énergie nécessaire. Tous ces véhicules doivent donc embarquer avec eux une certaine quantité de cette matière, quantité d’autant plus faible que celle-ci contient beaucoup d’énergie. Par exemple, la réaction de combustion de 30 kg d’essence dans l’oxygène de l’air fournit, en plus de 45 kg de vapeur d’eau et 92 kg de dioxyde de carbone plutôt indésirables, l’énergie suffisante pour parcourir 600 km en voiture sur route lisse et horizontale.
Mais au fond, d’un point de vue énergétique, un animal est-il si différent? Pas tellement, car chez tous les animaux, c’est également une réaction d’oxydation qui fournit l’énergie nécessaire à la locomotion. Notre carburant n’est ni le lithium, ni l’essence, ni le diesel, mais une petite molécule au goût sucré que l’on trouve par exemple dans le miel: le glucose. Il est présent dans le sang, mais nous n'avons pas besoin d’en manger directement car le corps peut le fabriquer à partir d’autres substances: sucres lents, protéines ou graisses. Les graisses détiennent d’ailleurs le record en termes de concentration d’énergie: à partir de 100 g d’huile, on obtient l’énergie équivalente à 200 g de glucose, soit de quoi parcourir 20 km à pied.
Notons que l’énergie contenue dans ce que l’on mange provient toujours d’une plante, qui a converti en énergie chimique l’énergie solaire captée par ses feuilles: c’est la réaction de photosynthèse, qui permet aux betteraves de fabriquer du sucre, par exemple. Ceci reste vrai pour un régime carnivore, car la vache et le cochon ont nécessairement tiré leur énergie d’une plante (ou d’un animal qui a mangé un animal qui (…) a mangé une plante5 ). À la base de l’énergie contenue dans l’alimentation, on trouve donc toujours une plante transformant l’énergie solaire en énergie chimique6 .
Le carburant des véhicules ordinaires – voitures, bateaux, avions – diffère vraiment peu du carburant des animaux. Après tout, Rudolf Diesel a mis au point le moteur qui porte son nom pour permettre aux professionnels de l’alimenter avec de l’huile végétale. Et l’essor des agro-carburants, à base notamment de betterave ou de colza, montre bien qu’une voiture peut consommer ce qui finit ordinairement dans nos assiettes. D’un autre côté, les dérivés du pétrole, comme l’essence ou le kérosène, proviennent de la décomposition de micro-organismes fossiles, donc à nouveau de végétaux. Et le pétrole peut également nourrir des êtres vivants, comme le montre le projet de fabrication de nourriture humaine à partir de levures digérant des dérivés pétroliers7 .
Du point de vue de la chimie fondamentale donc, une voiture à moteur thermique, un bateau ou un avion tirent leur énergie de la même façon qu’un animal: à partir de l’activité photosynthétique de végétaux exposés à l’énergie solaire. Dans le cas des voitures électriques, la source d’énergie est contenue dans la batterie; il s’agit de certains métaux et d’oxydes choisis pour leur capacité à délivrer un courant électrique: lithium, nickel, etc. Ces substances sont oxydées, puis reconstituées lors de la recharge. Il s’agit donc encore d’un processus d’oxydation mais, contrairement aux deux cas précédents, à partir d’espèces chimiques ne provenant pas de l’activité de végétaux.
«La clé du mystère des muscles réside dans l’existence de “moteurs moléculaires”, des protéines particulières qui ont la capacité d’engendrer un mouvement à partir d’énergie chimique.»
Muscle vs moteurs
Ainsi, dans leur principe fondamental d’utiliser l’oxydation de certaines molécules pour obtenir de l’énergie mécanique, le muscle, le moteur thermique et le moteur électrique présentent de fortes analogies. Mais le muscle présente une différence intéressante avec les deux autres. Dans le cas du moteur thermique, l’énergie chimique est exploitée pour obtenir de hautes températures et une explosion, qui provoquent le mouvement de pistons dans le cylindre, et donc de l’énergie mécanique. Le muscle, en revanche, fonctionne à température ambiante, sans explosion. En cela, il se rapproche du véhicule électrique, qui ne chauffe pas non plus. Mais le moteur électrique, lui, utilise des courants électriques, des aimants et, surtout, une pièce mobile tournant autour d’une pièce fixe, donc le principe de la roue – inconnu du vivant.
Le muscle présente donc un fonctionnement intéressant : il transforme l’énergie chimique en mouvement directement, sans passer par l’intermédiaire «chaleur» ni par l’intermédiaire «électricité8 », sans piston ni roue. Comment cela est-il possible? La clé du mystère des muscles réside dans l’existence de «moteurs moléculaires», des protéines particulières qui ont la capacité d’engendrer un mouvement à partir d’énergie chimique, et ce au niveau microscopique. Concrètement, chacune de ces protéines, dans certaines conditions et en présence d’énergie, peut se contracter de quelques nanomètres9 .
Chaque contraction isolée représente un mouvement évidemment imperceptible, mais la coordination d’un très grand nombre de ces mouvements minuscules permet d’obtenir un mouvement macroscopique, de quelques centimètres pour une contraction musculaire ordinaire. Il faut donc imaginer, quand on lève le bras, que des millions de milliards de microscopiques protéines se contractent en même temps: un système très différent de la mise en mouvement d’un piston dans un cylindre ou du passage d’un courant dans un bobinage électrique! Ce moteur extraordinairement astucieux, qui se passe de roue et de haute température, est donc basé sur l’action collective et synchronisée d’entités de petite taille, et non pas sur le mouvement d’une grande pièce macroscopique comme dans les moteurs artificiels.
Biomimétisme
Cette façon de générer du mouvement, sans chauffer et pour ainsi dire in situ, dans la masse musculaire même, intéresse les ingénieurs: certains voient dans la construction de «moteurs moléculaires synthétiques» une solution d’avenir pour construire de très petites machines, qui pourraient s’avérer – sur certains plans – plus efficaces que le moteur thermique ou électrique traditionnel. Voilà un exemple ambitieux de biomimétisme, c’est-à-dire d’ingénierie humaine basée sur l’imitation de la nature. On en revient alors à notre question de départ: si, actuellement, les véhicules humains sont à maints égards fort différents des animaux, certaines inventions y ressembleront peut-être davantage d’ici peu. Ainsi, certains bateaux auront peut-être un jour, sinon des jambes, au moins des muscles…
- 1https://bostondynamics.com/
- 2Notons qu’à l’échelle microscopique, il existe tout de même des «moteurs moléculaires» rotatifs, notamment dans les flagelles, sortes d’hélices naturelles.
- 3Il existe tout de même, dans le désert, des buissons qui roulent, les «virevoltants». Mais on ne peut parler véritablement de roue, puisqu’il n’y a pas d’essieu.
- 4Et encore quelques autres exceptions: bateau à voile, véhicule solaire.
- 5On pense notamment aux vaches nourries aux farines animales.
- 6Nous savons depuis 1977 qu’il existe des exceptions à cette règle, notamment dans les grands fonds ou dans certaines grottes isolées.
- 7Ce qu’on a appelé «les steaks de pétrole» dans les années 1960.
- 8Les muscles sont parcourus par des courants électriques; toutefois, ceux-ci n’ont pas un rôle énergétique, mais de commande.
- 9Un nanomètre = un milliardième de mètre.