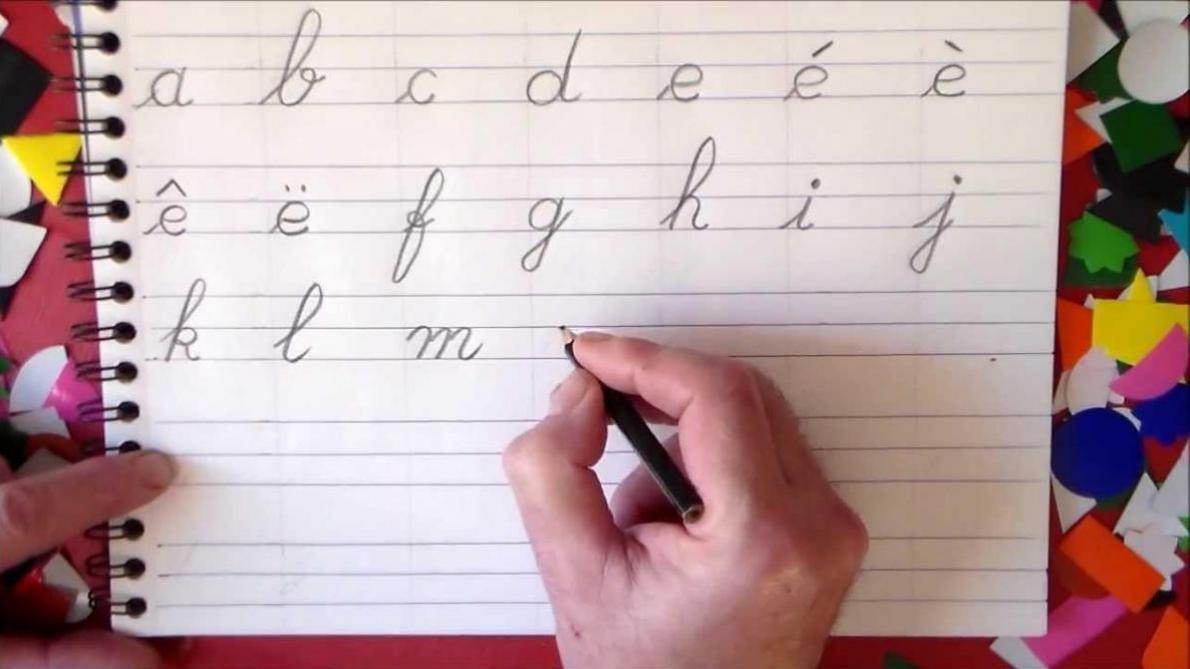
L’éducation permanente n’est pas concevable sans public. Définissant la nature même de son action, le public, très varié, est son principal moteur. Allons faire un tour sur le terrain du FLE (Français Langue Étrangère) à Bruxelles…
Nous avons rencontré Pamela Cecchi, formatrice en FLE à la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente, depuis janvier 2015.
Éduquer: Peux-tu nous décrire ton travail en tant que formatrice en FLE au sein de la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente?
amela Cecchi: Je travaille à la Ligue depuis janvier 2015 au sein du secteur interculturel où je dispense des cours de FLE à un public multiculturel à Bruxelles. Le secteur interculturel c’est avant tout une équipe qui se compose de formatrices, réalisant des projets de didactique, rassemblant de multiples compétences et issues d’horizons divers. Même si le projet est officiellement reconnu dans le secteur de la cohésion sociale, le travail effectué s’apparente à une approche d’éducation permanente.
Éduquer: Qu’est-ce que l’éducation permanente pour toi?
P.C: Pour moi, l’éducation permanente ce serait l’idée d’une action qui va au-delà de l’éducation obligatoire. Les personnes y chercheraient une éducation supplémentaire à un moment donné de leur vie, il ne serait plus question d’offrir un large panel de savoirs et de matières comme c’est le cas à l’école, mais des savoirs et des outils sur un sujet donné.
Éduquer: Quel est ton public?
P.C: La plupart des apprenants qui arrivent à mon cours font en général partie de deux catégories: il y a ceux qui sont là parce qu’ils sentent qu’ils ont besoin de s’insérer dans la société, les cours de FLE constituent alors une belle manière de créer des liens sociaux. Et puis, il y a toutes celles et ceux qui sont soumis à l’obligation de prendre des cours de français par le CPAS, ou parce qu’ils demandent la nationalité belge, par exemple. Ceux-là sont obligés de suivre une forme d’enseignement du français. Mon groupe d’apprenants (aussi bien composé de femmes que d’hommes) est donc assez varié. Certains ont très vite été déscolarisés dans leur pays d’origine et souhaitent juste avoir un certain niveau de français pour pouvoir suivre leurs enfants à l’école. Ce qui est déjà honorable. A côté de cela, d’autres ont fait des études supérieures et viennent avec l’idée de trouver du travail grâce aux cours de français. Tous n’ont donc pas nécessairement comme objectif de retourner sur le marché de l’emploi. Ils sont aussi en recherche d’un encadrement ou d’un bagage. Et puis, au-delà de cela, ils trouvent dans les cours, un espace pour échanger, ils peuvent venir avec des questions qu’ils n’oseraient peut-être pas poser dans un milieu plus institutionnalisé… Il y a donc peu de personne qui viennent chercher des cours de français, à proprement parler. Nos apprenants et apprenantes sont davantage dans une recherche de lien social. Ils souhaitent avoir des informations sur notre système, notre culture. Ils souhaitent pouvoir se retrouver, à un moment donné, dans un «cadre belgo-belge», rencontrer des gens qui sont dans la même situation qu’eux, socialiser et parfois aussi retrouver cette contrainte scolaire qui peut les rassurer.
Éduquer: Au-delà de l’apprentissage du français, quels débats ou activités mets-tu en place pour encourager tes apprenant·e·s à devenir des citoyennes actif·ve·s?
P.C: Ce que j’essaie de faire dans mon projet c’est, d’une part, de faciliter leur quotidien, leur permettre d’avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir vivre le mieux possible en Belgique, et d’autre part, le plus souvent c’est de leur permettre de continuer à développer leur autonomie intellectuelle. De cette manière, au moment où ils seront confrontés à un problème qui nécessite de la réflexion, ils pourront se débrouiller du mieux possible. L’ambition est qu’ils aient les ressources, qu’ils puissent solliciter les outils ou les personnes qui pourraient les aider. Cela leur permet aussi de ne pas perdre ou ne pas accéder à des droits parce qu’ils n’auraient pas compris certaines choses.
Éduquer: Justement, ont-ils une bonne connaissance de leurs droits?
P.C: Non! Pas du tout! Surtout que certains viennent de pays où leurs droits sont bafoués. Il faut les familiariser à l’environnement dans lequel ils sont aujourd’hui, leur expliquer comment cela se passe en Belgique et quels sont leurs possibilités. Nous devenons donc des référents.
Éduquer: Tu deviens donc pour eux, une interlocutrice privilégiée. Cela dépasse donc ta fonction de base qui est de penser la didactique et de dispenser du FLE?
P.C: Totalement! C’est toute la différence entre notre lettre de mission et le terrain. Il y a un monde entre le cadre dans lequel on exerce et la réalité. Avec le confinement, la réalité est devenue encore plus dure: en plus, il n’est plus possible de donner cours en collectivité. Est-ce que pour autant qu’on ne sert à rien? Non, car, comme je le disais, l’essentiel de notre travail ce n’est pas de simplement donner cours. Le français est toujours un prétexte pour faire autre chose, aborder d’autres thématiques! Le français en lui-même n’est pas l’objectif de notre travail. Nous sommes des sortes de «tutrices» sur lesquelles ils et elles peuvent se reposer. On est parfois confrontées à des situations extrêmes. Il y a, par exemple, des cas de maltraitance où les apprenants ont besoin d’aide concrète, que ce soit au niveau humain ou au niveau juridique. Ils se retrouvent alors dans des procédures qui sont extrêmement compliquées pour eux. Il y a, en plus, tout un racisme administratif, quand on ne parle pas bien le français, on peut très facilement être malmené dans nos sociétés.
Éduquer: Par rapport au racisme justement, j’imagine qu’il faut faire un gros travail sur soi en tant que formatrice pour mettre à mal les stéréotypes qui nous traversent?
P.C: Complètement! Nous sommes tous socialement normés. Nous devons nous méfier de nous-mêmes quand on travaille dans le milieu interculturel car on transmet des valeurs, des raisonnements. C’est pourquoi il est fondamental de se remettre constamment en question quand on travaille avec des cultures différentes. Au sein d’une même nationalité, il y a des histoires, des parcours, même des croyances très différentes. C’est donc très important de s’adapter, comme on le ferait avec toute personne, peu importe sa nationalité. Par exemple, je pense que la plupart de mes apprenants se sentent émancipés! Ce qui se passe c’est que notre vision de l’émancipation est très différente de la leur. Pour nous, l’émancipation d’une femme, c’est de travailler, ne pas toucher de chômage, de ne pas dépendre de son mari… Pour certains, l’émancipation c’est tout autre chose! Il faut donc constamment déconstruire ces clichés dont nous sommes, nous-mêmes, pétris.
Éduquer: Vous sentez-vous assez soutenues, en tant que formatrices, dans votre travail?
P.C: Globalement, la force que l’on a, c’est la liberté de fonctionner comme on le souhaite. Mais c’est une situation à double tranchant car cette liberté implique également le fait que l’on doive se débrouiller seules pour gérer les choses. Et puis, on doit parfois fonctionner avec des bouts de chandelles, nos locaux, par exemple, sont peu adaptés pédagogiquement à l’apprentissage d’une langue ou peu propices au débat. Donc non, les moyens ne sont pas toujours mis en place, mais la liberté que nous avons au sein même de nos activités pallie cette situation.
Éduquer: Une dernière question… Aimes-tu ton métier?
P.C: J’aime beaucoup mon métier! J’aime le fait d’être en contact avec des gens qui ont toujours une histoire individuelle très forte et qui ont des profils singuliers. Ce qui est super dans nos projets c’est que l’on part d’un projet personnel où il est possible de faire et de tester des tas de choses, d’en tirer des expériences pédagogiques et didactiques fortes. J’ai donc une grande liberté pour étayer ma réflexion pédagogique, avec en plus des gens qui ont des profils suffisamment différents, pour pouvoir en tirer des conclusions. Par contre, c’est un emploi qui est très - trop – prenant, c’est difficile de m’imaginer faire faire cela pendant 20 ans! On est quotidiennement confrontées à des histoires personnelles très difficiles, on est en contact avec des réfugiés de guerre, des gens qui fuient des situations catastrophiques dans leurs pays d’origine. On ne peut pas faire ce travail à la légère, on s’adresse à des gens qui ont besoin d’aide. Il est donc difficile parfois de poser des limites au niveau de l’investissement.
Sommaire du dossier: L'Éducation permanente, une démarche fondatrice de la démocratie culturelle
- Éducation populaire, Éducation permanente…toute une histoire!
- «L’éducation par le peuple et pour le peuple»
- Éducation permanente, droits culturels et démocratie culturelle - Quel horizon pour l’éducation permanente?
- L’Éducation permanente sur le terrain: une rencontre
- L’institutionnalisation de l’éducation permanente dans les politiques publiques
- Ressources



