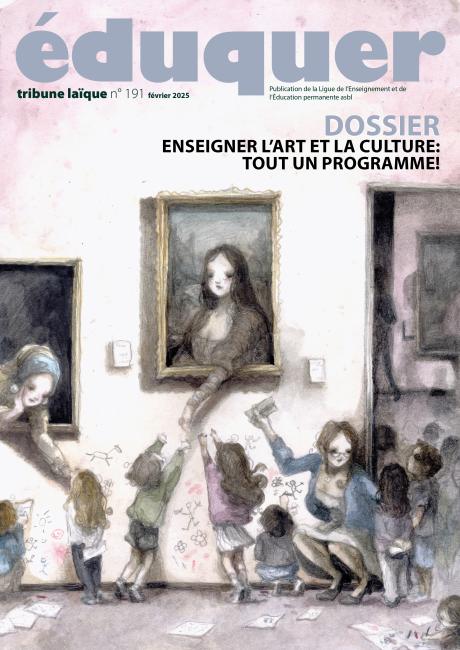Brève histoire de la pensée écologique et enseignements pour le présent
Mercredi 29 janvier 2025

Une brève histoire de l’écologie dans le monde occidental révèle plusieurs problématiques interdépendantes, parmi lesquelles la question de la protection de la nature, la critique de la croissance et la gestion des risques techniques. Parcours à travers une variété de travaux et de positions à cet égard, afin de cerner les principaux enjeux de l’écologie actuelle.
S’il y a bien une idée qu’il faut remettre en question concernant l’écologie, c’est qu’il s’agirait d’une notion − certains diront d’une mode − toute récente. En 1970 par exemple, des millions d’Américains défilaient pour demander un meilleur respect de l’environnement dans ce qui est devenu annuellement le Jour de la Terre. Et ce n’est là qu’une manifestation récente d’une écologie occidentale moderne. En réalité, des idées écologiques se retrouvent depuis des siècles chez de nombreux auteurs et autrices, dans de nombreuses traditions ou pensées.
Certes, il n’est pas facile de définir ce que l’on pourrait appeler une «pensée écologique»1 . Un certain nombre de thèmes en font partie, plus ou moins mêlés, avec une large variété d’accents. Pour reprendre une expression un peu éculée, il y a bien plus que cinquante nuances de vert… Dans cette brève analyse, nous verrons notamment apparaitre trois axes de préoccupations récurrents. La protection de la nature, le questionnement de l’économie (ou de la croissance, ou du développement) et la gestion des techniques.
Écologie et nature
Le mot écologie est forgé en 1866 par un biologiste allemand, Ernest Haeckel, sur la racine oikos (maison, habitat) et logos (science). L’approche de la nature par l’écologie dite scientifique met en évidence l’importance des milieux et des interactions entre éléments naturels. Il n’est pas encore question des impacts humains. Les ressemblances avec le concept d’économie sont remarquables, puisque ce terme est forgé sur oikos également, accolé cette fois à nomos (mesure). L’écologie et l’économie ont en commun d’étudier des évolutions de systèmes via de nombreux éléments en interaction. Toutefois, les principes et pratiques de l’économie contemporaine sont fortement en décalage et contradictions avec les principes écologiques, nous y reviendrons2 .
Aux XVIIIe et XIXe siècles, Darwin, Linné, Buffon ou Von Humboldt représentent autant de savants qui, s’ils ne peuvent être qualifiés d’écologistes, participent grandement à mieux connaitre la nature dans le monde entier. Des réserves naturelles sont ensuite mises en place pour protéger certaines zones. Un auteur américain influent du nom d’Aldo Leopold, appelle à «penser comme une montagne», c’est-à-dire pas uniquement comme un être humain qui se sert d’un espace naturel, mais comme une montagne qui abrite de nombreuses espèces en interdépendance. Ancien chasseur, forestier, il devient un précurseur de la vision d’une nature qui dispense des bienfaits à ceux et celles qui la visitent sans vouloir l’exploiter3 .
On peut distinguer aussi avec Arne Naess, philosophe norvégien du XXe siècle, une écologie «superficielle» et une écologie «profonde». Cette dernière va notamment considérer une valeur intrinsèque pour les formes de vie, alors que le plus souvent nous protégeons l’environnement dans un but plus utilitariste: en fonction des besoins humains (y compris de beauté et d’agrément).
Aujourd’hui, les initiatives cumulées de protection de la nature ne parviennent pas à enrayer les chutes massives et rapides de biodiversité dans le monde4 . La cause principale en est le changement d’affectation des terres, principalement en faveur de l’agriculture et dans une moindre mesure pour d’autres activités humaines, sans oublier les pollutions, les espèces invasives favorisées par les transports et le changement climatique. Les principaux outils de «conservation» de la nature (une expression anglophone) restent les espaces protégés, dont on cherche à étendre la surface.
Cependant, dans les pays tropicaux, où la biodiversité est la plus importante (elle est en rapport direct avec la latitude, en augmentant vers l’Équateur), trop souvent on n’a pas mis en place de collaboration avec les populations qui vivent ou vivaient dans ces espaces, à partir de leurs ressources. Cette protection de la nature sans les humains illustre, parfois dramatiquement, une problématique clé de la pensée écologique: comment définir avec les populations concernées les priorités en matière de protection de l’environnement. Ces priorités ne sont pas identiques selon les populations, leurs habitudes, leur culture, leur richesse et leur organisation économique.
Le développement et ses risques
Étendant cette problématique, abordons à présent la question plus large des rapports entre écologie et développement à travers quelques repères. Un auteur qui a lancé un questionnement voué à perdurer en ce domaine est Thomas Malthus. Ce révérend anglais du XVIIIe siècle s’inquiétait de la hausse de population qui ne serait plus en rapport avec les ressources alimentaires. Cette préoccupation s’est poursuivie jusqu’aujourd’hui mais au niveau global, à travers l’idée que les êtres humains seraient trop nombreux et que la Terre n’aura plus assez de ressources pour leur permettre de se nourrir5 .
En 1972, le rapport au Club de Rome Les limites de la croissance illustrait cette idée à travers des scénarios estimés pour le XXIe siècle. Il s’y ajoutait un élément absent de l’époque de Malthus: le rôle des pollutions qui affectent la santé et les équilibres écologiques eux-mêmes − pensons en particulier au changement climatique. Ce rapport au Club de Rome, ou rapport Meadows, dont ont été vendus 12 millions d’exemplaires en 37 langues, évalue les besoins en matières premières, en alimentation, mais aussi les conséquences en termes de pollution, d’une croissance qui se poursuivrait constamment, bien que de façon très inégale, sur Terre. Comme l’écrivait le penseur anglais Kenneth Boulding, «celui qui croit qu’une croissance exponentielle peut se poursuivre toujours dans un monde fini est soit un fou soit un économiste».
On le voit, la relation difficile entre croissance et écologie entre ici par la grande porte. C’est qu’elle apparait de plus en plus préoccupante à mesure que de nouvelles techniques confèrent à l’être humain un pouvoir de s’étendre toujours plus massivement via ses pratiques industrielles et agricoles.
Développement durable
Vers le milieu des années 1980 et surtout durant les années 1990, un compromis est élaboré à travers la figure du développement durable. Celui-ci vise à concilier économie et écologie, social et environnement, Nord et Sud, présent et futur. Plutôt que de s’en tenir à la croissance comme seul critère de progrès, c’est un mode de développement donnant la priorité aux «besoins essentiels» qui est prôné, avec des trajectoires «soutenables» pour l’environnement, sans oublier le souci des générations futures.
En 1992, la Conférence de Rio pour l’environnement et le développement, malgré toutes les critiques dont elle fait l’objet à l’époque, représente rétrospectivement un moment d’espoir, via l’initiation de nouvelles politiques, comme des Conventions sur le climat ou sur la biodiversité, qui demeurent toujours les cadres principaux au niveau international. De marginal dans les politiques, le souci pour l’environnement gagne alors du galon, des plans incluant sa prise en compte dans différents secteurs se multiplient.
L’institutionnalisation du développement durable, puis de la transition écologique, avec une approche voisine, se poursuit dans les années qui suivent. En 2017, Nicolas Hulot, ministre de la Transition en France, devient «numéro 3» du gouvernement, ce qui est révélateur. Cependant, pour prendre ce cas emblématique, il démissionnera en arguant de ce que ses priorités ne sont pas suffisamment reconnues.
«Les prix sont loin de refléter les dégâts engendrés par les biens et services, et par conséquent de nombreux aspects de l’environnement et certains éléments de qualité de la vie se dégradent.»
Décroissance(s)?
On retombe ainsi sur le dur de l’opposition entre écologie et économie, qui n’avait en fait jamais disparu. Via ce qu’on appelle la «modernisation écologique»6 , il est possible de réaliser des réformes partielles, sur base de techniques, de régulations, d’expertises, pour limiter les dégâts générés par la société industrielle dans certains pays et si possible en générant des bénéfices. Mais fondamentalement, le moteur de croissance se poursuit et s’amplifie en gagnant les pays émergents dans le monde. Les prix sont loin de refléter les dégâts engendrés par les biens et services, et par conséquent de nombreux aspects de l’environnement et certains éléments de qualité de la vie se dégradent.
Face à ces questions, il existe toute une variété de critiques plus ou moins virulentes de la croissance, et derrière elle de l’économie dominante (qu’elle soit productiviste, capitaliste ou de grande consommation). Le terme de «décroissance» est forgé en France au tournant des années 2000. Il a de nombreux sens et de nombreux précurseurs, chacun à leur façon7
: Ivan Illich, Léon Tolstoï, Gandhi, Gunther Anders, les courants du post-développement, voire Épicure, des sagesses antiques ou certains aspects du christianisme, peuvent y trouver des places. Il ne s’agit donc pas au sens propre de décroissance économique, mais de décroissance d’éléments jugés nuisibles, sachant que d’autres aspects vus comme favorables à la vie sociale devraient croitre.
Ces courants critiquent fortement le développement (y compris durable) et généralement pour deux types de raisons: des impacts trop élevés sur l’environnement et une incapacité de type plus éthique à apporter le bonheur ou une qualité de vie véritable. Que le «bien-être» soit avant tout une accumulation «d’avoir» représente pour ces courants une impasse. Persuadés que les relations sont plus essentielles que la consommation, on retrouve par exemple dans ces courants le slogan «moins de biens, plus de liens». L’interrogation sur les finalités de la consommation voire de l’existence n’est pas éludée, même si elles apparaissent de façon variée.
«Le développement d’une technique, d’un produit ou d’une substance devrait chercher à connaitre et à éviter une série d’effets pas nécessairement désirés, mais existants, et cela dans un rayon assez large, y compris dans le temps.»
Technologies et sociétés
Après ces quelques repères sur des visions de protection de la nature puis de critique du développement, considérons certains questionnements techniques qui sont eux aussi inséparables de la pensée écologique. En réalité, nous les avons déjà vus en partie à l’œuvre dans ce qui précède. Car ce sont bien certains effets de développements techniques massifs qui entraînent des questions nouvelles auxquelles cherche laborieusement à répondre l’écologie.
L’historien John R. McNeill montre magnifiquement comment le XXe siècle − qui verra la nature profondément modifiée − amène des transformations d’une ampleur inédite, au point qu’il intitule son ouvrage, en référence à la Bible, Du nouveau sous le soleil8 . Dans la même veine, mais en mettant aussi en évidence les choix politiques adoptés pour y parvenir, les historiens Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz retracent la montée vers l’Anthropocène, à savoir un âge géologique où l’espèce humaine devient le principal facteur de changement9 .
Comment gérer ce pouvoir technique qui procure tant de retombées à l’économie, au profit, et permet de répondre à toutes sortes de désirs dès qu’ils sont solvables? Indéniablement, les impacts qui prolifèrent ainsi nous mettent à l’épreuve. Aujourd’hui par exemple, l’intelligence artificielle se développe à une vitesse non anticipée, générant des quantités considérables d’émissions de gaz à effet de serre non prévues dans les scénarios. Une enquête récente révèle que les PFAS, ces polluants «éternels», nécessiteraient des sommes se comptant en centaines de milliards d’euros pour pouvoir en décontaminer l’Europe, jusqu’à 40 milliards rien que pour la Belgique10
.
On s’interroge alors sur la gestion déficiente qui a conduit à de tels errements, sachant qu’ils sont loin d’être isolés. En ce domaine une figure initiatrice se détache, celle de Rachel Carson. Cette journaliste fut la première aux Etats-Unis à attirer l’attention, dans son livre Printemps silencieux (1962), sur les effets négatifs des pesticides utilisés en grande quantité après la guerre. Carson poussa à formuler des principes qui anticipaient le principe de précaution. Une idée clé étant que le développement d’une technique, d’un produit ou d’une substance devrait chercher à connaitre et à éviter une série d’effets pas nécessairement désirés, mais existants, et cela dans un rayon assez large, y compris dans le temps.
Certains diront que ce type de principes ne peut être suffisamment mis en vigueur qu’en s’interrogeant aussi sur le prix que l’on est prêt à payer pour ces précautions, et en parallèle sur l’utilité des biens ainsi produits. C’est ainsi que, en dépit des différences nombreuses entre les courants, on perçoit tout de même une certaine cohérence dans les questionnements reliés à l’écologie.
«Lorsque la conjoncture économique se dégrade, comme c’est le cas actuellement, on observe que la demande d’action écologique perd du terrain dans l’opinion.»
Autres courants, complexité et enseignements
Nous n’avons pas la place ici pour évoquer d’autres courants qui pourraient se rattacher aux questionnements précédemment soulevés, tels que l’écomarxisme, l’éco-anarchisme, l’écoféminisme, la justice écologique, l’écologie décoloniale ou encore la collapsologie. Il existe aujourd’hui parmi les jeunes générations une prolifération de questionnements où la radicalité est nourrie par les impasses, les doutes et les anxiétés émanant de problèmes écologiques qui se renforcent.
À cela s’ajoutent les effets de moyens de communication qui nous rendent sensibles à des réalités autrefois moins apparentes dans bien des domaines. Un exemple emblématique en écologie est la question des élevages industriels, où la maltraitance montrée en gros plan a certainement favorisé des mobilisations à cet égard plus grandes que par le passé.
Pour autant, l’ensemble de la population n’est pas convaincu qu’il y ait des changements prioritaires à apporter pour tenir compte de ces questions et/ou ne sait pas très bien comment s’y prendre. Lorsque la conjoncture économique se dégrade, comme c’est le cas actuellement, on observe que la demande d’action écologique perd du terrain dans l’opinion11
. De plus, un grand flou et une complexité règnent dans les perceptions de ces sujets, sans oublier une part active de désinformation.
Quels enseignements tirer de cet éclairage partiel et partial sur différents aspects de la pensée écologique? D’abord, pour rapide qu’il soit, cet éclairage aura peut-être convaincu la lectrice et le lecteur de combien les problématiques interdépendantes reflétées ici sont riches, fondamentales et parfois existentielles. Nous sommes loin de la caricature que l’on voit parfois des écolos «rigides» ou «excessifs»: ces questionnements concernent véritablement chacun et chacune d’entre nous. Cependant, deuxième enseignement, elles nous touchent de façon différente selon notre position. Contrairement à un adage souvent entendu, par rapport aux menaces environnementales, nous ne sommes pas tous dans le même bateau12
. Face aux pollutions générées comme aux dommages subis, les inégalités peuvent être considérables parmi des parties de la population, et plus encore à travers des pays du monde. L’enjeu futur de la pensée écologique est sans doute là: traduire de façon juste et convaincante de nombreux sujets difficiles, pour permettre de se les approprier et de conduire davantage de changements protégeant la vie et les sociétés.
- 1BOURG D. et PAPAUX A. (dir.). Dictionnaire de la pensée écologique, PUF, 2015.
- 2Certaines de ces contradictions sont analysées, au quotidien, dans ZACCAI E. Contradictions ordinaires, Samsa, Bruxelles, 2024 : https://edwin.zaccai.web.ulb.be/
- 3https://www.rfi.fr/fr/podcasts/des-%C3%A9cologistes-remarquables-portra…
- 4KOLBERT E. La 6e extinction, Le Livre de Poche, 2017.
- 5Actuellement, ce n’est pas le cas et les famines sont avant tout le résultat de la pauvreté dans certaines régions.
- 6https://www.revuepolitique.be/une-modernisation-ecologique-simplificatr…
- 7LATOUCHE S. Les précurseurs de la décroissance, Le passager clandestin, Paris, 2016; COCHET Y. Antimanuel d’écologie, Bréal, 2009.
- 8Par opposition à l’Ecclésiaste, qui proclame qu’«il n’y a rien de nouveau sous le soleil» dans un passage fameux. McNEILL J.R. Du nouveau sous le soleil. Une histoire de l’environnement mondial au XXe siècle, Points, 2013.
- 9BONNEUIL C. et FRESSOZ J.-B. L’Événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Points, 2016.
- 10https://www.rtbf.be/article/enquete-100-milliards-d-euros-par-an-a-perp…
- 11 https://www.edf.fr/groupe-edf/observatoire-international-climat-et-opin…
- 12https://www.revuepolitique.be/nous-ne-sommes-pas-tous-dans-le-meme-bate…