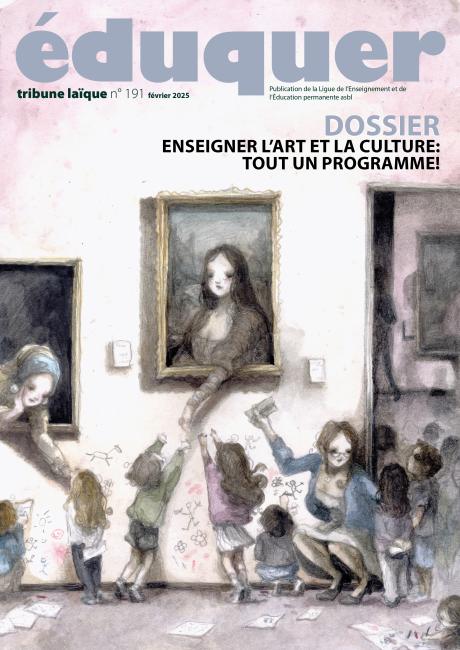Une étude de l’Observatoire des politiques culturelles chiffre à 14% l’absence de fréquentation des institutions culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors que le niveau de diplôme est fréquemment pointé comme facteur déterminant, que peut l’enseignement devant ce constat?
L'équation semblait simple: plus on est diplômé·e, plus on fréquenterait les lieux culturels. Pourtant, malgré l'augmentation du nombre de diplômé·es en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), la fréquentation des institutions culturelles stagne, voire recule. L’Observatoire des politiques culturelles de la FWB révèle qu’un peu plus d’une personne sur dix (14%) ne se serait pas rendue dans une institution culturelle lors des douze derniers mois. Une notion large qui englobe cinémas, musées, salles d'exposition, festivals, sites historiques, bibliothèques, spectacles de cirque, concerts, pièces de théâtre, opéras ou spectacles d’humoristes.
La baisse de la fréquentation de ces lieux n’est cependant pas nouvelle. L’étude Pratiques et consommations culturelles de la population en Fédération Wallonie-Bruxelles, publiée en 2020 par le même Observatoire, soulignait déjà un recul des activités culturelles extérieures1
. Parallèlement, le taux de diplomation connaît une croissance significative: 11% pour les bacheliers et 44% pour les masters (périodes 2004-2005 et 2015-2016)2
.
Des auditoires aux parterres des théâtres
«Le niveau de diplôme apparaît comme l'une des variables les plus significatives dans l'analyse des pratiques culturelles», indique Maud Van Campenhoudt, docteure en sciences sociales et chercheuse pour l’Observatoire des politiques culturelles. La dernière grande enquête quantitative sur la FWB publiée en 2020 par la chercheuse rapporte que «88% des personnes ayant un niveau d'études primaires n'ont pas assisté à une représentation théâtrale au cours des douze derniers mois. Un chiffre qui s’élève à 56% chez les personnes diplômées du supérieur.»
Une différence observable dans d’autres secteurs culturels, que la sociologue tient à nuancer: «Si les personnes diplômées du supérieur fréquentent davantage les théâtres que celles ayant un niveau d'études plus faible, les relations entre ces variables se complexifient lors d'une analyse plus fine des variables explicatives (âge, sexe, niveau de diplôme, lieu de résidence). La réalité est plus complexe qu'une simple relation de cause à effet.»
L'héritage de Bourdieu: la valeur du goût
La relation entre position sociale et goûts culturels s'inscrit dans la lignée des travaux de Pierre Bourdieu. Le sociologue a démontré comment la culture tient un rôle d'instrument de «domination symbolique». La haute culture et la culture populaire se retrouvent dans un rapport hiérarchique, les pratiques culturelles devenant des marqueurs de distinction sociale.
Chercheuse post-doctorante en sciences sociales au centre de recherche METICES de l'Université libre de Bruxelles, Emilie Garcia Guillen apporte son éclairage: «Selon Bourdieu, les goûts ne définissent pas une valeur en soi, mais un positionnement social. Les bons goûts sont ceux que la classe dominante parvient à imposer comme légitimes. Cette hiérarchisation, bien que relativement instable, n’en imprègne pas moins le corps social.»
«Définir un bon élève est plus simple que définir le bon goût, poursuit-elle. L’institution scolaire produit un système d’évaluation tangible: les résultats scolaires et les diplômes classent les élèves entre “bons” et “moins bons”. En revanche, aucune autorité ne possède les compétences pour définir ce que serait le bon goût. Une multitude d’instances se font concurrence afin de le définir.» Ce contexte de concurrence relève de ce que le sociologue Pierre Bourdieu qualifie de «champ»: une situation où différentes forces s'affrontent pour établir leur légitimité. L'école, jadis hégémonique, partage désormais son influence avec les médias, Internet et les groupes de pairs.
Du bon goût au goûter bien
La massification de l'enseignement supérieur a profondément bouleversé la transmission des goûts culturels. Autrefois réservé aux classes dominantes, l'enseignement supérieur s'est ouvert à des étudiant·es de milieux divers, apportant leur propre bagage culturel. Emilie Garcia Guillen résume: «L’école a progressivement perdu une partie de son autorité dans la définition de ce qu’est le bon goût. Les bons élèves n’ont plus forcément de bons goûts. Aujourd’hui, selon la théorie développée par Peterson, la compétence principale des classes dominantes en termes de niveau socioéconomique et de diplôme − parmi lesquels des "bons élèves" ont donc plus de chances de figurer − serait leur aptitude à naviguer entre des répertoires culturels extrêmement variés.»
Le concept d'«omnivorité», avancé par Richard Austin Peterson, caractérise cette évolution. Il renvoie à la capacité à piocher dans différents registres culturels des plus valorisés ou moins valorisés. Cette notion brise-t-elle la correspondance entre bons élèves et bons goûts? «Pas tout à fait…, répond la sociologue. Le niveau d'éclectisme des goûts s’accroit avec le degré de diplôme. Certains sociologues contemporains postulent que la distinction s’opère moins à partir des produits consommés que sur la manière de les consommer. Finalement, la question n’est pas tant de savoir si les bons élèves ont de bons goûts, mais s’ils goûtent bien.»
De la démocratisation de la culture à la démocratie culturelle
La marge d’action de l’enseignement face à ce constat s'inscrit dans une histoire plus large des politiques culturelles en Europe. Dans l'après-guerre, celle-ci porte une ambition claire: la démocratisation de la culture. «Rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité», selon le discours prononcé en 1959 par le ministre français des Affaires culturelles, André Malraux3
. Mais de nombreux obstacles − des conditions de travail aux barrières d'accès aux œuvres − ont continué d’entraver l’accès des classes populaires à une grande partie de cette culture.
Les années 1980 marquent un tournant avec l'émergence d'une nouvelle approche: la démocratie culturelle. Cette évolution répond à plusieurs bouleversements sociétaux: l'essor des industries culturelles, la montée des mouvements individualistes et l'affirmation progressive d'un droit à la culture, dans un contexte de libéralisation du secteur. Durant cette période, les institutions culturelles se multiplient, le nombre de musées passant de 20 000 à 100 000 à l'échelle mondiale.
Ce changement de paradigme rebat profondément les cartes: il ne s'agit plus uniquement de rendre la culture accessible, mais de reconnaître la diversité des expressions culturelles. L'école se trouve ainsi face à un nouvel enjeu: plutôt que d'imposer une culture légitime aux élèves, son défi est désormais de valoriser et d'enrichir leurs pratiques culturelles existantes.
- 1VAN CAMPENHOUDT M. et GUÉRIN M. «Pratiques et consommations culturelles de la population en Fédération Wallonie-Bruxelles», Études n°8, 2020.
- 2ARES. Indicateurs de l'enseignement supérieur: https://www.ares-ac.be/fr/statistiques/indicateurs
- 3Création du ministère des Affaires culturelles ; André Malraux ministre, Paris, 3 février - 24 juillet 1959
l'Observatoire des politiques culturelles: une approche scientifique des politiques culturelles
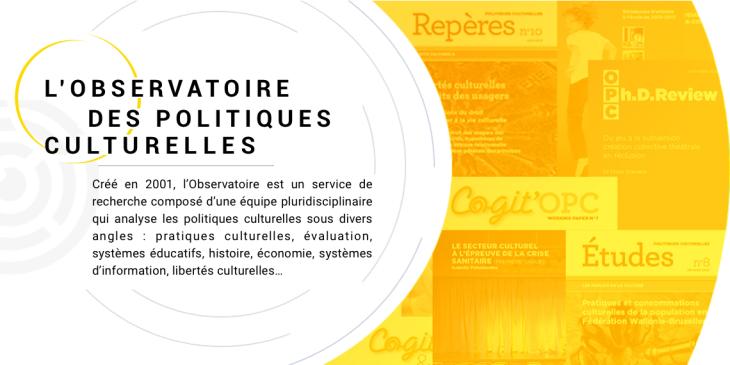
Par qui sont visités nos musées? Comment évoluent nos pratiques de lecture? Quels sont les nouveaux modes de consommation culturelle?
Depuis 2001, l'Observatoire des politiques culturelles (OPC) scrute les tendances et évolutions du paysage culturel francophone. Véritable baromètre culturel, cet observatoire est rattaché au Secrétariat général de la FWB. Une position stratégique à l'intersection des différentes administrations: culture, enseignement, relations internationales et recherche.
Son équipe pluridisciplinaire, composée de sociologues, anthropologues, historien·nes et spécialistes de la communication, dissèque les habitudes culturelles des francophones. Une mine d'informations qui guide les politiques culturelles, alimente la recherche et éclaire le secteur sur ses propres mutations.
Plus d’infos: https://opc.cfwb.be/