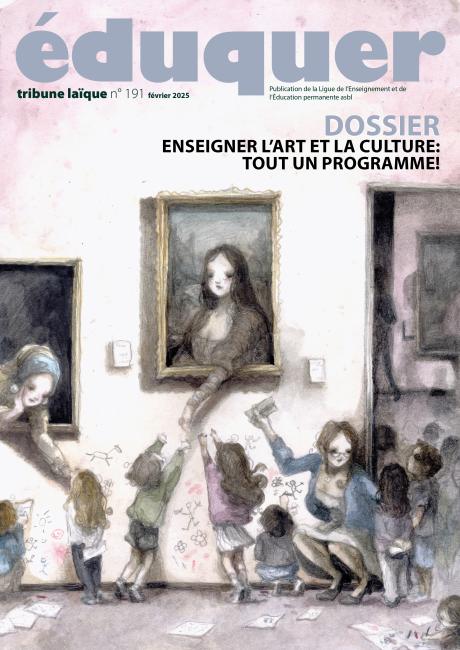Parmi les choses fabuleuses que permet l’intelligence, l’une des plus fondamentales est sans doute celle-ci: la possibilité d’établir des liens entre des observations. Cette compétence, pas du tout limitée à l’humain, permet par exemple de savoir que tel nuage est lié à tel risque météorologique; que telle plante en forêt s’accompagne de tel gibier intéressant; que la proximité du soleil avec la constellation du Grand Chien annonce des périodes de fortes chaleurs1 .
Pour notre survie et, de façon générale, pour donner de la cohérence au monde, nous sommes en permanence occupés à établir des corrélations entre des observations, c’est-à-dire à constater le fait que deux événements ont tendance à aller ensemble ou, au contraire, à s’exclure mutuellement. Le premier type de lien est dit corrélation positive: «Plus l’événement A se réalise, plus l’événement B se réalise souvent». Par exemple, plus il y a de glaces vendues en Belgique, plus on y compte de noyades (nous y reviendrons). À l’inverse, la corrélation négative est illustrée par cette constatation: plus on vend d’huîtres en Belgique, moins on observe de noyades dans le pays.
Une corrélation, c’est donc simplement ce qu’on exprime en langage courant de notre pays par «Au plus A, au plus B»2
ou par «Au plus A, au moins B». Il existe d’autres types de corrélations, mais nous nous limiterons à ces deux liens principaux.
«D'une cause déterminée résulte nécessairement un effet; et, inversement, si aucune cause déterminée n'est donnée, il est impossible qu'un effet se produise» (Spinoza).
Causalité: des électrons au bébé
La causalité, quant à elle, peut se définir comme l’influence par laquelle un événement A (cause) contribue à la production d’un autre événement B (conséquence). Autrement dit, avec la causalité, il y a l’idée d’un enchaînement nécessaire, et qui s’inscrit dans le temps: A a lieu, puis B a lieu. Et, toutes choses égales par ailleurs, si A n’est plus présent, B sera moins présent, voire absent. Citons ici le philosophe Spinoza qui, avec cette claire expression de la causalité, pose une des fondations de la science moderne: «D'une cause déterminée résulte nécessairement un effet; et, inversement, si aucune cause déterminée n'est donnée, il est impossible qu'un effet se produise3
».
L’influence causale de A sur B a lieu via des interactions que l’on peut qualifier selon les cas de biologiques, culturelles, administratives, législatives, psychologiques ou autres, mais qui peuvent in fine toujours s’expliquer par des interactions physiques (atomes, rayonnement) et pouvant être décrites par les lois de la nature. Par exemple, l’enchaînement de causalité entre l’attirance sexuelle mâle-femelle et la naissance subséquente d’un individu immature chez les mammifères est d’ordre biologique (voire psychologique et culturel si on parle de notre espèce) mais peut se traduire en termes de chimie et, in fine, en termes d’interactions entre électrons. On peut en dire autant d’un crime comme cause d’une condamnation pénale, de l’ouverture d’un courrier de l’administration fiscale comme cause de panique, d’une conférence comme cause de bâillement, etc.
«Une corrélation n’indique pas nécessairement une causalité.»
Noyades et huîtres, chocolat et Nobel
Revenons aux noyades et aux glaces: peut-on affirmer qu’il y a lien de cause à effet? C’est-à-dire si, toutes choses égales par ailleurs, on promeut la vente d’huîtres ou si on décourage la vente de glaces, observera-t-on moins de noyades? Non, très probablement. La corrélation entre noyade et pratiques alimentaires s’explique simplement par le fait que les noyades en Belgique ont lieu surtout en été, saison des piscines et des baignades à la mer. Ici, les ventes de glaces et les noyades ont une «cause commune supérieure», qui est l’augmentation des températures. De même, l’arrivée du froid est une cause commune supérieure expliquant la corrélation négative entre vente d’huîtres et noyades.
Nous voyons par cet exemple qu’une corrélation n’indique pas nécessairement une causalité. On peut trouver une myriade d’exemples plus ou moins comiques du même ordre. Citons par exemple, chez les enfants, la corrélation positive entre pointure et étendue du vocabulaire (qui s’explique par le fait qu’en grandissant, on acquiert du vocabulaire: la cause commune est donc le développement de l’enfant!), celle entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel par pays (qui s’explique probablement par le fait que les pays riches consomment du chocolat et ont les moyens de payer un système de recherche de qualité4 : la cause commune est ici la richesse d’une nation).
Cinq nuances de corrélation: le piège de la causalité
Nous venons de voir qu’une corrélation peut provenir d’un effet de cause commune: appelons cela, d’après le dernier exemple, l’«effet choco-Nobel». Mais il existe également d’autres façons d’expliquer une corrélation du type «Au plus A, au plus B». Par exemple, que penser de la corrélation entre dépression (A) et solitude (B)? Peut-être que solitude est cause de dépression, mais il se peut que dépression soit cause de solitude! Autrement dit, la causalité peut aller de B vers A! Peut-être même que les deux sens existent, engendrant une sorte de «cercle vicieux» solitude-dépression-solitude. De tels cercles («vicieux» ou «vertueux») se trouvent souvent en sciences: par exemple, manger du sucre perturbe les micro-organismes de notre intestin, mais ces perturbations pourraient nous donner envie de sucre5
!
Ensuite, il peut arriver que des corrélations soient le fruit du hasard. En cherchant dans les milliards de données existantes, on finit par trouver des liens entre variables. Un mathématicien américain s’est amusé à relever quelques-unes de ces corrélations amusantes, en inventant des liens de cause à effet fantaisistes, précisément dans le but de mettre en garde contre le piège de la causalité6
: on apprend, entre autres histoires absurdes, que le nombre de sorties de films de Disney est positivement corrélé avec le nombre de vols de véhicules à moteur. Enfin, bien sûr, il se peut que A soit la cause de B, comme dans la corrélation entre consommation de cigarettes et risque de cancer du poumon.
Résumons: une corrélation, c’est-à-dire une observation du type «Au plus A, au plus B» peut donc révéler cinq scénarios: 1) cause commune supérieure: il existe une cause C, qui provoque simultanément A et B (effet «choco-Nobel»); 2) B est la cause de A (causalité dans le sens inverse de ce que l’on pourrait penser); 3) B est la cause de A, et de plus A est la cause de B (cercle vicieux); 4) coïncidence pure (Walt Disney et vols de voitures); 5) A est la cause de B (cigarettes et cancer du poumon).
Sur ces cinq scénarios, seul le dernier («A est la cause de B») est celui que nous avons tendance à déduire naturellement de la phrase «Au plus A, au plus B». Déduire une causalité «A cause B» d’une corrélation est donc tentant, mais souvent faux, puisqu’il existe quatre autres explications possibles. C’est ce que nous appelons ici le piège de la causalité.
Un travers bien humain
Revenons sur une phrase de corrélation en prenant un nouvel exemple: «Les personnes végétariennes ont plus de chances de développer une dépression»7 . Sans une solide dose de méfiance, il est presque impossible de ne pas déduire une causalité de cette phrase! Un travers bien humain… qui vient notamment de ce que végétarisme et dépression sont présentés dans cet ordre. Le végétarisme semble préexister, donc nous sommes tentés de le voir comme une cause de la dépression, qui arrive en deuxième. Or, on pourrait énoncer cette corrélation dans l’autre sens: «Les personnes dépressives ont plus de chance d’adopter un régime végétarien»! Cette deuxième phrase donne l’idée (tout à fait plausible!) d’une causalité dans l’autre sens, avec une dépression préexistant au végétarisme. Dans les deux cas, la phrase porte déjà en elle une asymétrie qui nous fait tomber dans le piège!
Pour éviter cela, une formulation neutre d’une corrélation devrait donc présenter les deux faits exactement sur un pied d’égalité. Hélas, quelle que soit la façon dont on s’y prend pour essayer de rester neutre, on nomme un des deux événements en premier! À moins peut-être d’écrire les deux mots de façon superposée8 , quelque chose comme «On observe une corrélation entre être v d é é g p é r t e a s r s i i e f n». On pourrait alors prononcer la phrase à deux voix en superposant les deux mots… pas très académique!
Prendre conscience de la différence entre corrélation et causalité, notamment avec l’explication de la «cause supérieure commune» (penser à l’effet «choco-Nobel»!), permet d’éviter de nombreuses erreurs logiques, et de rester très prudent·e face à des corrélations qui nous tendent le piège de la causalité. Par exemple, «Je dors moins bien à la nouvelle lune » peut s’expliquer sans évoquer une causalité lune-sommeil, mais comme ceci9 : la période la plus difficile financièrement est souvent la fin du mois; or la nouvelle lune, en ce moment, tombe vers le 27 ou 28. L’insomnie de la nouvelle lune pourrait donc être plutôt liée à l’anxiété financière10 .
Difficile d’établir la causalité
Alors, comment prouver un vrai lien de causalité? C’est très difficile! Si on reprend le végétarisme et la dépression, il faudrait d’abord proposer une explication détaillée, donc un mécanisme (chimique, social, psychologique, etc.). Par exemple: telle carence du régime végétarien implique telle variation de l’humeur. Ou bien, le végétarisme peut conduire à une exclusion sociale, et à une dépression. Ou alors, dans l’autre sens: la dépression peut conduire à la solitude, donc on ne participe plus aux rituels collectifs où l’on consomme de la viande. Ou encore, la dépression nous rend plus sensible au sort des animaux d’élevage, et incite au végétarisme11
.
Puis il faudrait réaliser une étude pour tester l’hypothèse. Une étude, donc, où l’on puisse tester l’effet d’une cause toutes choses égales par ailleurs. Ceci se fait au moyen de deux groupes, l’un contenant la cause supposée et pas l’autre. Pour respecter le toutes choses égales par ailleurs, les deux groupes doivent se ressembler le plus possible, notamment en termes d’âge, de condition socio-économique, d’habitudes de mode de vie, etc. L’examen du devenir de ces deux groupes, combiné à une analyse statistique correcte, pourra conclure à une présomption plus ou moins forte de causalité. Beaucoup de travail donc!
Désapprendre la tendance à la causalité
En conclusion, il faut rester méfiant·e face à des phrases annonçant une corrélation, car elles recèlent souvent des pièges! Bien souvent, elles suggèrent perversement une cause sans l’établir: «Le régime A est corrélé à la diminution de la maladie B», «Faire régulièrement C augmente les chances de D», «Plus le taux de E est élevé, plus le risque de F diminue», «Plus une ville compte d’immigrés de G, plus les délits H augmentent », etc.
Pour éviter le piège de la causalité, il faut essayer de désapprendre notre tendance à voir de la causalité là où elle ne se trouve pas. Pour cela, on peut considérer les quatre autres options possibles, en particulier l’effet «choco-Nobel». On apercevra alors la possibilité d’explications inattendues, et pas toujours là où on pensait les trouver!
- 1D’où le terme de «canicule».
- 2Belgicisme!
- 3SPINOZA Baruch. Œuvres IV: Ethica (Éthique), édition critique et texte établi par Fokke Akkerman et Piet Steenbakkers, Presses universitaires de France - PUF, rééd. 2020, 691 p.
- 4On parle ici des trois prix Nobel scientifiques: chimie, physique, médecine.
- 5Ainsi, en forçant un peu le trait, on peut voir l’amateur de sucre qui ouvre les placards de sa cuisine en croyant exercer son libre-arbitre comme un véhicule commandé par les micro-organismes de son intestin ! Cet effet rappelle ce qui a été observé chez les «fourmis zombies», envahies par un champignon qui en prend littéralement le contrôle dans le but de disséminer des spores.
- 6https://www.tylervigen.com/spurious-correlations
- 7KOHL IS., LUFT VC., PATRÃO AL., MOLINA MDCB., NUNES MAA., SCHMIDT MI. «Association between meatless diet and depressive episodes: A cross-sectional analysis of baseline data from the longitudinal study of adult health (ELSA-Brasil)», J Affect Disord. 2023 Jan 1;320:48-56. doi: 10.1016/j.jad.2022.09.059. Epub 2022 Sep 23. PMID: 36162679.
- 8Ce que justement nous faisons pour nos étudiant·es.
- 9On peut imaginer encore d’autres explications : par exemple, à la campagne, on peut penser que les cambrioleurs travaillent moins pendant les pleines lunes, d’où une vigilance accrue en nouvelle lune.
- 10Les corrélations mettant en jeu la lune fascinent… et s’expliquent en grande partie par des «effets choco-Nobel» («lune rousse» qui brûle les plantes au printemps, lumière de la lune qui blanchit le linge, etc).
- 11On peut s’amuser à trouver d’autres explications possibles, liées par exemple aux revenus ou à la classe sociale.