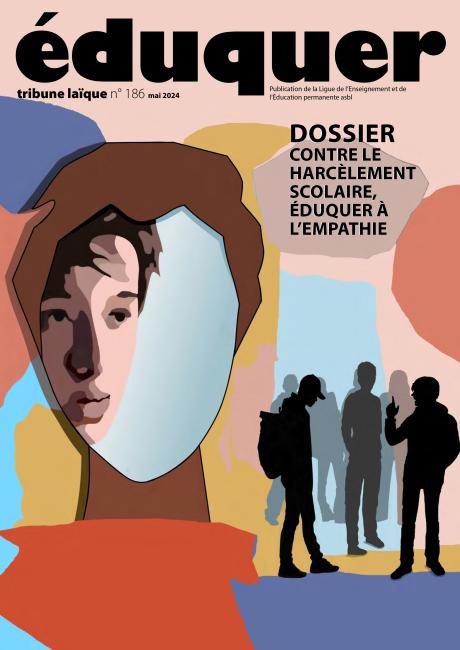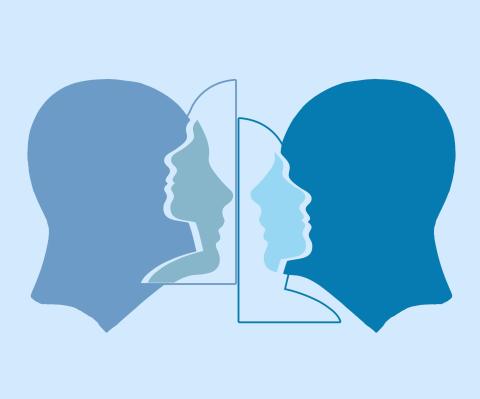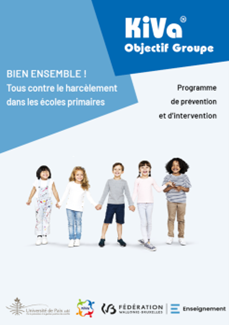Les sciences participatives ont le vent en poupe
Mercredi 24 avril 2024

Les démonstrations pédagogiques, les visites des coulisses et les rencontres avec les scientifiques sont autant d’initiatives que les musées entreprennent pour permettre à leur public – enfants, jeunes et adultes – d’entrer en contact direct avec la recherche qui s’y déroule. Au cours de la dernière décennie, une autre forme de médiation scientifique prend de l’ampleur: les sciences participatives. Au travers d’exemples concrets, explorons les aspects essentiels de la démarche participative au sein du musée, un tiroir à la fois.
Le projet «Citizen Rescuers for Collections» (CRESCO)1 marque une première collaboration entre une équipe de recherche et de conservation belge spécialisée en biologie du Musée royal de l’Afrique centrale (AfricaMuseum, Tervuren) et de l’Institut des Sciences naturelles (Bruxelles) et 26 citoyen·nes engagé·es dans une démarche de sciences participatives. L’acronyme «CRESCO», dérivé du latin signifiant «croître» ou «prospérer», reflète leur objectif commun d’accroître les connaissances sur la biodiversité. En effet, les spécimens naturels préservés dans les musées renferment des données qui sont essentielles pour les chercheuses et chercheurs étudiant l’évolution du climat et des environnements naturels.
«Les sciences participatives ne se résument pas uniquement à l’acquisition de données plus rapidement et à moindre coût. Elles impliquent également un engagement personnel profond de la part des individus.»
Réconcilier publics et collections
L’Institut des Sciences naturelles héberge une impressionnante collection de 17 millions de spécimens d’insectes. Quant à la collection d’oiseaux de l’AfricaMuseum, elle compte 150.000 spécimens. La xylothèque de Tervuren, l’une des plus importantes bibliothèques de bois au monde, renferme plus de 81.000 échantillons provenant de plus de 13.500 espèces différentes. Au cours des trois mois qu’a duré le projet, les participant·es ont photographié 3000 oiseaux et ont préparé 1300 échantillons de bois.
De plus, quelque 2300 étiquettes d’acariens ont été transcrites à domicile grâce à la plateforme en ligne de crowdsourcing DoeDat2
, développée par l’équipe du Jardin botanique de Meise. La transcription de ces anciennes étiquettes de collection manuscrites, parfois âgées de cent ans, représente un travail que même les logiciels de reconnaissance optique de caractères les plus performants ne peuvent accomplir.

Cette implication citoyenne a permis de rendre visibles des spécimens qui auraient sinon sombré dans l’oubli, illustrant ainsi la valeur précieuse de la collaboration entre la science et la société pour l’enrichissement de nos connaissances sur le monde.
Cependant, les sciences participatives ne se résument pas uniquement à l’acquisition de données plus rapidement et à moindre coût. Elles impliquent également un engagement personnel profond dans le projet de la part des individus, qu’ils émanent des mondes de la conversation, de la recherche ou du public.

Au musée ou à la maison?
Oui, il est tout à fait possible de produire des connaissances en tant qu’amateur ou amatrice, sans disposer d’une formation scientifique. La démocratisation des compétences dans le domaine des loisirs actifs, qu’ils soient pratiqués en solitaire ou en groupe, ouvre la voie à l’innovation et à la créativité pour toutes et tous3
.
Internet joue un rôle crucial dans ce processus, offrant une plateforme pour transmettre des apprentissages et pour collaborer à grande échelle. Des plateformes qui regroupent différents projets telles que Zooniverse4
ou DoeDat facilitent cette transmission des connaissances et permettent à chacun et chacune, quel que soit son âge, de participer activement à la construction et au partage des savoirs scientifiques. Ces plateformes couvrent un large éventail de disciplines, allant de l’astronomie à l’archéologie et de l’ornithologie à l’histoire. Explorer la surface de la planète Mars, compter des pingouins en Antarctique ou déchiffrer des enluminures médiévales sont à portée de clic.
Les participant·es virtuel·les sont tout autant en demande de contact et de sens que les participant·es in situ. Une utilisatrice de longue date de la plateforme DoeDat et participante du projet CRESCO attire notre attention sur cet aspect: «Peut-être [organiser] un moment ou une action d’appréciation pour les volontaires Internet? Suggestions: visite des coulisses afin qu’un bénévole qui n’a pas ou peu d’expérience se fasse une idée des collections pour lesquelles il transcrit des données, comprenne les processus et méthodes nécessaires pour conserver ou constituer une collection, et se fasse une idée générale du fonctionnement d’un musée en tant qu’institution scientifique et publique».
Quant aux activités in situ à l’AfricaMuseum, le projet CRESCO a eu un impact significatif sur le renforcement de la communauté. En effet, les participant·es ont déclaré avoir rencontré de nouvelles personnes lors de leur participation au projet, souvent différentes d’eux en termes d’âge, de niveau d’éducation ou de statut social. Le projet a renforcé leur confiance dans leur communauté locale et dans le musée.
Une recherche participative in situ implique une série d’interactions et d’échanges en personne, auxquels aucune expérience virtuelle ne peut se comparer, renforçant ainsi le rôle communautaire du musée en tant que lieu de rencontre.
«Ce qui anime les participant·es, c’est leur connexion profonde avec le sujet de la recherche. Cette affinité peut être présente dès le départ ou se développer progressivement tout au long de la recherche.»
Loisir et apprentissage
Il est essentiel que les participant·es comprennent pleinement leur tâche et les raisons de leur mission. Les objectifs du projet doivent être clairs, avec une vision précise du processus. Cela implique de définir les enjeux, à la fois pour l’équipe de recherche et pour les personnes qui participent. Quelles sont les questions de recherche auxquelles on souhaite répondre? Quelles sont les meilleures méthodes pour y parvenir? Comment les données collectées sont-elles partagées et conservées? Une véritable négociation s’amorce, qui nécessite l’utilisation de méthodes participatives pour garantir l’engagement et la compréhension de toutes les parties prenantes.
Le musée, en tant qu’espace de médiation scientifique, joue un rôle essentiel dans la cultivation de la passion et de l’apprentissage personnel. Les participant·es sont guidé·es par leur curiosité, leurs émotions, leur passion et leur attachement par rapport à certains sujets. Olayemi, un jeune étudiant de nationalité nigérienne ayant participé au projet CRESCO, explique qu’il souhaitait «contribuer aux avancées scientifiques susceptibles de façonner un avenir plus durable et plus vert». Il a aidé l’équipe de recherche de l’AfricaMuseum à créer des modèles d’intelligence artificielle pour repérer les espèces de bois protégées qui entrent en Europe par le port d’Anvers. L’exploitation illégale des forêts est un sujet brûlant dans son pays natal.
La digitalisation des échantillons de bois par les participants de CRESCO constitue un excellent exemple de la façon dont un type de participation peut mener à une autre. En 2023, les participant·es ont commencé par poncer ces échantillons et à en prendre des photos. Aujourd’hui, cinq d’entre eux analysent les caractéristiques anatomiques du bois, atteignant ainsi un degré de participation encore plus élevé et devenant de véritables collaborateurs et collaboratrices du projet.
Ce qui anime les participant·es, c’est leur connexion profonde avec le sujet de la recherche. Cette affinité peut être présente dès le départ ou se développer progressivement tout au long de la recherche.

Tous et toutes scientifiques?
Pendant des siècles, seules les personnes aisées et privilégiées avaient accès à la pratique scientifique. Aujourd’hui, les sciences participatives touchent un public de plus en plus large et diversifié. Être scientifique citoyen·ne n’est plus réservé à une élite, mais à toutes celles et ceux qui trouvent une motivation et un sens à faire de la science. Ce nouveau rapport permettrait-il de trouver de meilleures solutions à des problèmes sociaux et environnementaux?
En 2022, CurieuzenAir5
, la plus grande campagne de sciences participatives à Bruxelles, a livré ses résultats. Trois mille Bruxellois ont évalué la qualité de l’air de la capitale en utilisant un appareil de mesure installé sur leur façade. La carte des mesures révèle un contraste marqué entre les quartiers socialement et économiquement défavorisés et les quartiers plus aisés. On garde en mémoire le grand pique-nique citoyen Picnic the Bridge organisé en été 2022 à la Porte de Flandre, carrefour le plus pollué de la capitale, pour attirer l’attention des autorités locales.
En Flandre, à l’initiative de la Jonge Academie Vlaanderen et du magazine de vulgarisation scientifique EOS, un site portail a été mis en ligne: Iedereen Wetenschapper6
(traduction: Tout le monde est un·e scientifique). Le site web est un agrégateur de tous les projets de sciences participatives en Flandre et aux Pays-Bas. En outre, des applications mobiles telles qu’Obsidentify, Seek ou Merlin pour l’ornithologie, permettent à tout naturaliste amateur ou amatrice – débutant·e ou expérimenté·e – de faire des observations directement dans la nature. Grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle, ces applications aident à identifier les spécimens et à envoyer les données aux chercheurs et chercheuses. La collecte d’images est «gamifiée» (rendue ludique) grâce aux missions de type «challenge», ce qui la rend adaptée à un public jeune et/ou scolaire.
Les sciences participatives ont développé des outils axés sur l’inclusivité. Plus la participation est diversifiée, plus il y aura de données disponibles, ce qui permettra de mieux refléter des réalités complexes.
Pour finir, qui décide?
La «participation» est souvent malmenée, réduite à un simple mot à la mode. Pourtant, véritablement participer implique une réflexion active, la formulation de questions, la collecte de données et la restitution d’un ou plusieurs éléments de réponse. Les sciences participatives intègrent ainsi des méthodes empruntées à l’éducation scientifique, telles que l’analyse des données et l’expérimentation, qu’elles combinent avec des approches issues des sciences sociales telles que la cocréation et la recherche-action. La participation ne se limite pas à une invitation symbolique à célébrer la fin d’un projet, mais elle implique une véritable coproduction des savoirs et une action communautaire.
Les musées combinent un ensemble de compétences scientifiques, éducatives, de communication et d’exposition qui agissent comme des catalyseurs pour les sciences participatives. Cependant, la résistance à la participation scientifique persiste. Il est crucial de comprendre qui détient l’autorité dans la recherche participative: le musée – et son équipe de recherche et de conservation – ou la personne qui participe?
Selon la définition adoptée en 2022 par le Conseil international des Musées (ICOM), le musée est une institution publique, au service de la société. Cela implique d’adopter des approches telles que la médiation-action et le design collectif, favorisant les relations humaines plutôt que la simple transmission de contenu. Repenser les modes de fonctionnement des organisations est essentiel: il ne suffit pas de donner la parole, il faut également faire émerger de nouvelles hypothèses sur le monde et les tester dans un esprit de collaboration et d’ouverture.
Les sciences participatives conjuguent la pertinence analytique de la science avec la force créatrice de l’apprentissage actif. Elles représentent un véritable trait d’union manquant dans le paysage des musées contemporains, pouvant combler l’écart symbolique entre la science et la société.
Plus d’infos sur les sciences participatives?
Visitez la page web https://www.africamuseum.be/fr/get_involved/citizen_science et abonnez-vous à notre newsletter.
Luiza Mitrache est diplômée en Sciences et Techniques dans la Société du Conservatoire national des Arts et Métiers (Paris), en Analyse et Technologie des Matériaux archéologiques (University College London) et en Histoire de l’Art (Université libre de Bruxelles).
Remerciements :
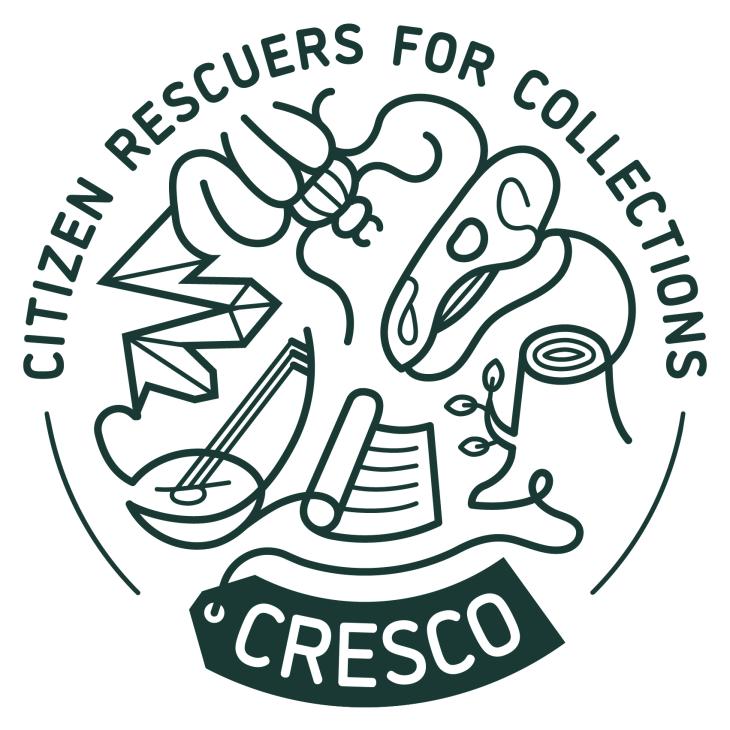
Le projet CRESCO a été réalisé grâce à l’engagement de la chercheuse Larissa Smirnova, du chercheur Ruben De Blaere et de la gestionnaire des collections Annelore Nackaerts du Musée royal de l’Afrique centrale, du conservateur Wouter Dekoninck de l’Institut des Sciences naturelles et de l’équipe participante composée de Jimmy Boogaerts, Fanny Cloutier, Michèle Florquin, Andrea Lopez Vignote, Veronique Maes, Viktoriya Nyevyerova, Philippe Quintin, Olayemi Razaq Saliu, Maureen Romont, Olha Sapunova, Frank Simoens, Raymonde Van den Stock, Annita Vignoli, Olena Zavorina et de la communauté DoeDat. Le projet a été soutenu financièrement par IMPETUS et par la Politique scientifique fédérale (BELSPO).
Quelques définitions:
Les sciences participatives revêtent des formes multiples, ce qui se reflète dans les multiples termes qui les désignent: science citoyenne, science communautaire, crowdsourcing, cocréation, intelligence collective. Les expressions «citizen science» (science citoyenne) et «citizen scientists» (citoyens scientifiques) sont entrées dans l’Oxford English Dictionary (OED) en juin 2014. La «science citoyenne» est définie comme un «travail scientifique entrepris par des membres du grand public, souvent en collaboration avec ou sous la direction de scientifiques professionnels et d’institutions scientifiques». Dans le monde francophone, le terme «citizen science» a été traduit par «sciences participatives».
Depuis le 24 août 2022, le Conseil international des Musées (ICOM) propose la nouvelle définition des musées suivante: «Un musée est une institution permanente, à but non lucratif et au service de la société, qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l’interprétation et l’exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. Les musées opèrent et communiquent de manière éthique et professionnelle, avec la participation de diverses communautés. Ils offrent à leurs publics des expériences variées d’éducation, de divertissement, de réflexion et de partage de connaissances.»
Participer à la recherche améliore les connaissances
Selon une enquête réalisée auprès des participant·es in situ (11 répondant·es) au projet CRESCO:
- 82% (9) des participant·es déclarent que le projet a amélioré leur compréhension du contenu, du processus et de la connaissance de ce qu’est la science.
- 73% (8) affirment que le projet a renforcé leurs compétences en matière de recherche scientifique, telles que la collecte, la conservation, l’analyse et l’interprétation des données.
- 55% (6) envisagent de poursuivre une carrière scientifique.
Références:
- BONNEUIL Christophe et JOLY Pierre-Benoît. Sciences, techniques et société, La Découverte, Paris, 2013.
- FLICHY Patrice. Le Sacre de l’amateur: sociologie des passions ordinaires à l’ère numérique, Seuil, Paris, 2010.
- HANOTEAUX Sven. Les Sciences participatives. Collaborations entre citoyens et scientifiques, La Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation Permanente, Bruxelles, 2017.
- SOEN Violet et HUYSE Tine. Citizen Science in Vlaanderen: U telt mee?! Standpunten van de Jonge Academie, De Jonge Academie, Bruxelles, 2016.