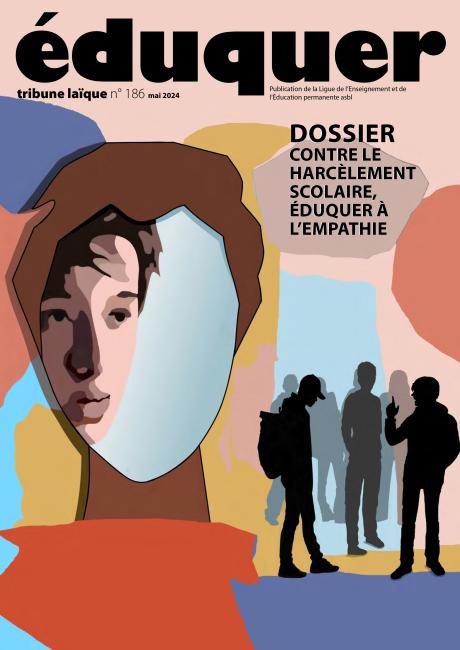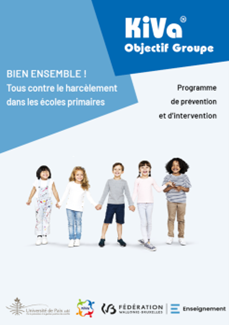Les neurones miroirs, pour le meilleur et pour le pire...
Lundi 13 mai 2024
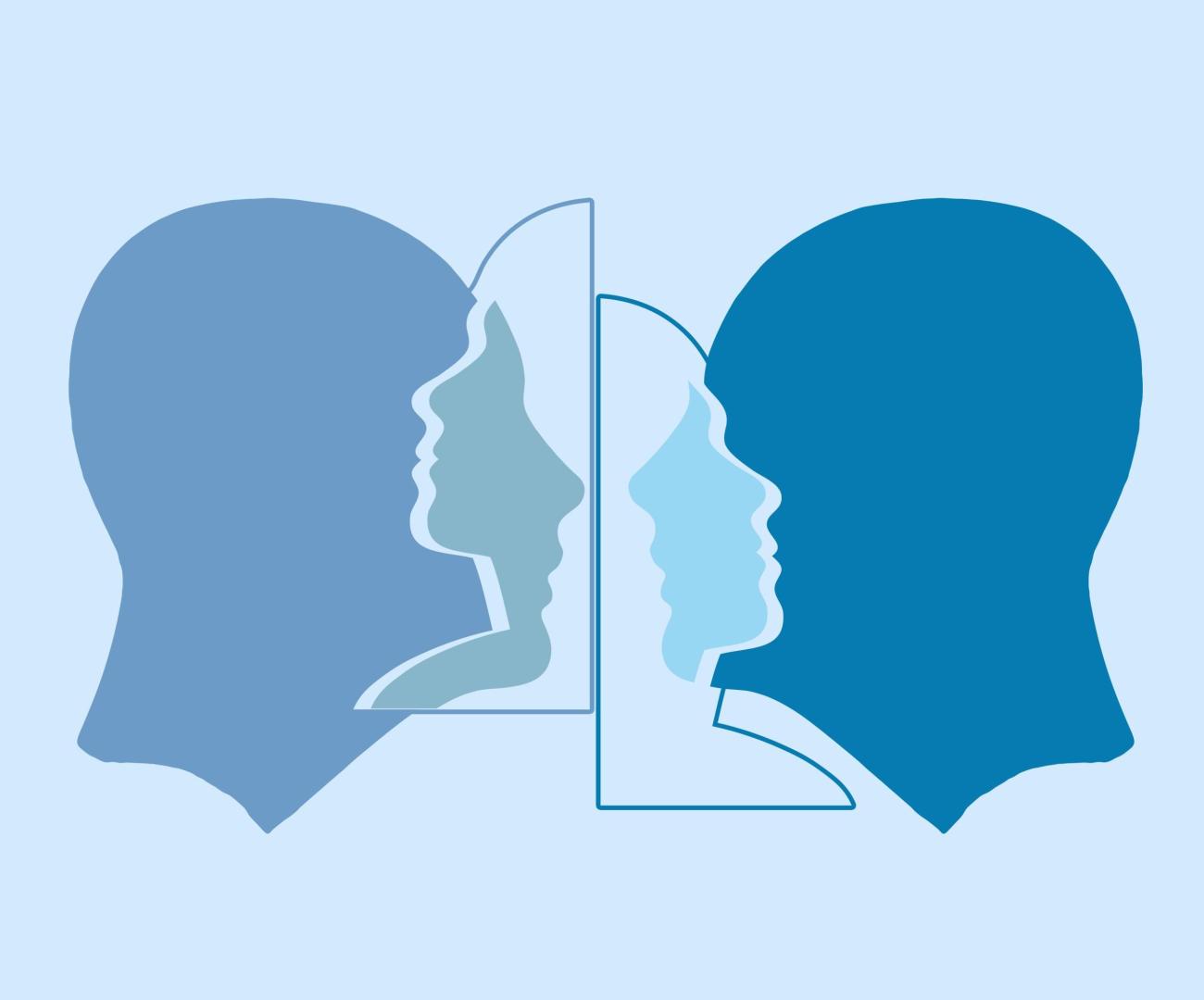
On invoque parfois un peu vite le rôle des neurones miroirs quand on suggère qu’ils suffisent à expliquer l’ensemble des attitudes positives qui permettent à un être humain de se mettre à la place d’un autre. Ce n’est évidemment pas si simple, et s’il suffisait d’activer quelques neurones pour venir à bout de l’agressivité humaine et s’opposer à toutes les formes de violences associées à des jeux de pouvoir mal contenus, il y a sans doute bien longtemps que l’être humain se serait donné les moyens de stimuler cette partie de l’équipement cérébral des uns et des autres...
Pour éprouver ce qu’une personne ressent, concevoir les états affectifs qui la traversent et, le cas échéant, en s’imaginant être à sa place sans se mettre à sa place, se laisser emporter par une forme de contagion émotionnelle qui induit un mouvement de compassion, de sympathie et, dans le meilleur des cas, d’empathie, on avance le rôle des neurones miroirs. Pourtant, l’empathie n’est ni une formule magique qui réglerait définitivement la problématique du harcèlement scolaire, ni un terme passe-partout qui permettrait de régler en deux temps trois mouvements tous les problèmes liés au vivre-ensemble, ni un concept à la mode qui, mis à toutes les sauces, constituerait le soubassement de la mise en mouvement de toutes les formes d’intelligence émotionnelle.
«On n’enseigne pas l’empathie comme on expliquerait une théorie. On l’apprend davantage concrètement, à partir de sa mise en mouvement pratique au sein d’un couple ou d’une communauté humaine.»
Ni une formule magique ni une matière à enseigner
Prétendre qu’il suffirait d’enseigner l’empathie pour contenir toutes les dérives liées aux conflits et aux jeux de pouvoir entre élèves est à la fois une hérésie et un contresens basé sur une mécompréhension fondamentale des mécanismes qui, chez l’être humain, provoque la réaction empathique.
On n’enseigne d’ailleurs pas l’empathie comme on expliquerait une théorie. On l’apprend davantage concrètement, à partir de sa mise en mouvement pratique au sein d’un couple ou d’une communauté humaine. Enseigner l’empathie reviendrait à se contenter d’expliquer un fonctionnement neuronal, en espérant qu’en provoquant une prise de conscience, la démonstration du fonctionnement suffirait à le provoquer. Apprendre l’empathie c’est, au contraire, se mettre dans les conditions effectives de son activation et éprouver ce qu’elle signifie quand la contagion émotionnelle produit ses effets.
Pour concevoir ce qui provoque l’empathie et crée la contagion émotionnelle, il faut en effet s’attarder à comprendre le fonctionnement de ces neurones tout à fait particuliers que l’on appelle les «neurones miroirs». Ce sont effectivement ces neurones qui, lorsqu’ils sont activés, créent un mouvement de compassion susceptible d’induire des gestes de consolation, de partage, d’apaisement, de réassurance ou de mise à distance.
Petite histoire des neurones miroirs
Les neurones miroirs fonctionnent comme des mini-capteurs d’informations qui nous rendent sensibles à ce que vivent les autres. Ils ont été découverts un peu par hasard au cours des années 1990 par Giacomo Rizzolatti, directeur du département de neurosciences de la faculté de médecine de Parme. Ayant constaté chez les macaques rhésus, dont il étudiait le comportement pour d’autres raisons, que les réflexes de mastication et de salivation s’activaient dès que ceux-ci observaient les chercheurs en train de manger, Rizzolatti en a déduit que les neurones pouvaient s’activer non seulement dans l’action mais aussi dans l’observation de l’action, dès que le sujet par la «pensée» ou «l’imagination» se mettait à la place de celui qu’il observe.
Rizzolatti en est ainsi arrivé à identifier dans le cortex ventral du singe une catégorie de neurones qui s’activaient sous le seul effet de l’observation des actions d’autrui. Ce type de neurones a par ailleurs ensuite pu être identifié chez d’autres animaux, et notamment chez certains oiseaux lors du chant et lorsque l'animal écoute un congénère chantant.
Quelques chercheurs en sciences humaines (notamment Frans de Waal, Jean Decety et Vittorio Gallese) se sont ensuite livrés à un certain nombre d’extrapolations à partir de cette découverte chez l’animal, pour en arriver à déterminer que, chez l’être humain, les neurones miroirs pouvaient également jouer un rôle important dans l'empathie, c'est-à-dire dans la capacité à percevoir et reconnaître les émotions d'autrui.

Contagion émotionnelle
Ils ont pour cela mis en évidence l’existence d'un système de «miroir» similaire pour les émotions. Ils ont ainsi montré ce qui se passait par exemple dans la partie antérieure de l’insula – le siège primaire des émotions – quand elle s’activait pour faire éprouver à une personne du dégoût à la simple vue de quelqu'un exprimant du dégoût. C’est cette découverte qui a permis d’éclairer d'un jour nouveau le phénomène connu de contagion émotionnelle interindividuelle.
En réalité, le système miroir des émotions permet non seulement de simuler l'état émotionnel d'autrui dans notre cerveau et, par conséquent, de mieux identifier les émotions éprouvées par les individus de notre entourage, mais les neurones miroirs seraient aussi impliqués dans la contagion motrice déclenchant une contagion émotionnelle via un processus de pré-empathie, précurseur de l'empathie véritable qui est dite aussi empathie secondaire ou empathie imaginative. La pré-empathie, ou empathie primaire, concerne quant à elle les jeunes enfants et se met progressivement en place entre 2 et 7 ans, à mesure qu'ils acquièrent diverses autonomies.
Les neurones miroirs expliquent notamment pourquoi un bébé qui voit ou entend un autre bébé pleurer va se mettre, lui aussi, à pleurer. Leur rôle est évidemment essentiel à tout ce qui stimule l’intérêt manifesté envers les autres par rapport à ce qu’ils vivent. En effet, ce sont ces neurones qui nous invitent à nous mettre à la place de ceux que nous regardons, à saliver lorsque nous les voyons manger ou à avoir les larmes aux yeux quand ils pleurent devant nous.
«L’intelligence émotionnelle, et plus précisément l’activité des neurones miroirs qui la conditionne, est essentiellement une affaire d’éducation et d’atmosphère culturelle.»
Stimulation genrée des neurones miroirs
Ces neurones miroirs fonctionnent dès le plus jeune âge et leur stimulation conditionne la vie sociale des bébés, des enfants et des adolescents, pour former les adultes qu’ils deviendront. Evidemment, s’ils sont davantage stimulés au cours de l’éducation, ils provoqueront un attrait plus ou moins prononcé en direction de toutes les activités de soutien social et les conduites de soin. C’est ce qui explique notamment que les garçons et les filles ont tendance à ne pas choisir les mêmes filières d’études et que les filles, parce que leurs neurones miroirs ont été davantage stimulés à travers les jeux qui leur ont été proposés précocement, optent davantage pour des professions d’aide, de soin et d’éducation.
Les neurones miroirs n’étant a priori pas distribués différemment en fonction du sexe de l’enfant, force est de constater qu’ils se révèlent particulièrement sensibles aux stimulations de l’environnement. L’intelligence émotionnelle, et plus précisément l’activité des neurones miroirs qui la conditionne, est donc essentiellement une affaire d’éducation et d’atmosphère culturelle.
«Pour le meilleur, les neurones miroirs constituent le moteur majeur de nos comportements d’empathie et de pré-empathie, mais pour le pire, lorsqu’ils sont stimulés sans discernement, ils mettent l’enfant, l’adolescent ou l’adulte sous l’emprise de l’envie.»
L’empathie et l’envie: les deux faces d’un même miroir
Le problème se corse évidemment lorsque l’on comprend le fonctionnement particulier de ces neurones miroirs et que l’on conçoit ce qu’ils signifient dans l’histoire du développement d’un enfant. Il faut en effet prendre en considération que ce matériel neuronal, au mieux, stimule l’empathie mais, au pire, sert de levier à l’envie des envieux.
Pour observer l’action de ce mouvement d’envie suscité par les neurones miroirs lorsqu’ils invitent l’enfant à «se mettre à la place» d’un autre que lui, il suffit d’installer deux enfants, dans une crèche ou ailleurs, devant le spectacle d’un autre qui s’amuse visiblement avec un jouet. Il leur faudra ce jouet-là et pas un autre, et très vite ils seront prêts à entrer en conflit avec le troisième pour se l’approprier. Aussi, dans les crèches «prévoyantes», tous les jeux existent en trois exemplaires. Ce principe de précaution permet d’éviter bien des situations conflictuelles provoquées par l’envie dans sa nature instinctive quand elle s’éveille sous l’effet des neurones miroirs.
Avers et envers d’une même médaille, l’activité neuronale en miroir peut ainsi soit créer de l’empathie, soit donner naissance à des comportements d’agressivité, à des attitudes de rivalité ou à des conduites asociales motivées par l’envie d’être à la place de l’autre pour éprouver une joie similaire à la sienne. Pour le meilleur, les neurones miroirs constituent donc le moteur majeur de nos comportements d’empathie et de pré-empathie mais pour le pire, lorsqu’ils sont stimulés sans discernement, ils mettent l’enfant, l’adolescent ou l’adulte sous l’emprise de l’envie.
Ainsi, agir sans discernement avec les neurones miroirs revient aussi bien à activer les mécanismes d’empathie, qui stimulent la compassion, qu’à provoquer ce sentiment mêlé d’irritation, voire de haine que l’on éprouve vis-à-vis de ceux qui possèdent ce que l’on n’a pas et en retirent ostensiblement du plaisir.
C’est pour cela qu’il vaut mieux, dès lors qu’il est question de stimuler l’empathie au sein d’une classe pour en améliorer le climat, disposer de techniques adaptées qui permettent de générer de la compassion, parce que l’on aura pris soin d’installer un contexte favorable à l’expression des émotions et à leur propagation par contagion. C’est précisément à cela que servent les espaces de parole régulés, quand ils sont mis en place au sein des écoles pour améliorer le climat de classe, prévenir les situations de harcèlement et y réagir lorsqu’elles se manifestent .
Cultiver l’empathie le plus tôt possible
On convoque généralement les neurones miroirs au tribunal des bonnes consciences pour souligner le rôle positif qu’ils jouent dès lors qu’il est question de stimuler l’empathie en permettant à celui qui observe l’état affectif de l’autre de ressentir ce que celui-ci éprouve. Pourtant ces mêmes neurones miroirs exercent également, nous l’avons vu, une influence négative sur nos manières d’être ensemble quand ils déclenchent l’envie, en font le moteur de la jalousie, de la soif de posséder ce qui appartient à l’autre ou la jubilation d’assister à l’humiliation de celui ou celle qui est brutalement éjecté·e de son piédestal.
Il ne suffit pas de laisser faire les neurones miroirs pour que tout aille bien. Il faut aussi, par l’éducation, les pousser vers le meilleur en évitant le plus possible ce qui les conduit au pire. C’est la raison pour laquelle il faut cultiver l’empathie le plus précocement possible chez l’enfant, continuer à la stimuler chez les adolescents et à la maintenir active tout au long de la vie adulte.