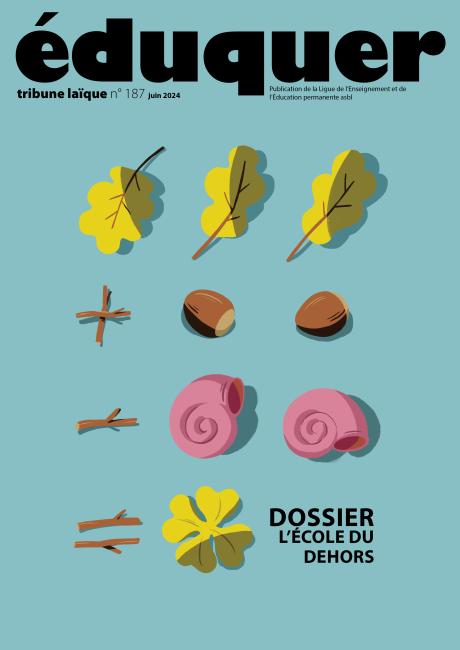Depuis le 7 mai, des étudiant·es de l’Université libre de Bruxelles protestent dans un bâtiment occupé au Solbosch. Dans le sillage du mouvement international des campus, cette occupation s’oppose aux partenariats académiques de l’ULB avec les universités israéliennes et manifeste son soutien au peuple palestinien.
Une occupation est menée dans l’enceinte de l’Université libre de Bruxelles (ULB) depuis le 7 mai dernier. En réaction à l’offensive israélienne menée à Gaza au lendemain des attentats du 7 octobre 2023, les étudiant·es demandent l’arrêt des partenariats scientifiques entre l’ULB et les universités israéliennes. En cela, l’occupation étudiante s’inscrit dans un mouvement international.
En avril, des étudiant·es de l’Université de Columbia plantent des tentes sur la pelouse du campus new-yorkais pour exiger de leur direction d’arrêter tous liens économiques avec Israël. D’autres universités étasuniennes rejoignent le mouvement, avant de s’étendre à l’échelle internationale avec des actions menées dans des universités françaises, espagnoles, allemandes ou encore japonaises.
En Belgique, le flambeau démarre de l’Université de Gand, où les étudiants occupent les locaux dès le 6 mai. Le lendemain, ce sont les étudiant·es de l’ULB qui prolongent le mouvement en occupant le bâtiment B, renommé pour l’occasion en bâtiment Walid Daqqa, écrivain et militant palestinien mort après 38 années de détention. Actuellement, sept universités belges sont occupées par des actions: Gand, Anvers, ULB, VUB, KU Leuven, UCLouvain et ULiège.
«C’est la première fois que je vois un mouvement étudiant avec une forme aussi inclusive et démocratique. Certain·es étudiant·es apprendront plus de ces semaines d’occupation qu’avec cinq années d’études.»
L’Université populaire de Bruxelles
Ces jours-ci, le campus du Solbosch baigne dans un climat de blocus1
. La bibliothèque est pleine d’élèves affrontant la dernière ligne droite avant les examens. De l’autre côté du campus, devant le bâtiment B, quelques jeunes discutent de la pensée d’Aimé Césaire en fumant des cigarettes roulées. Après les présentations, deux étudiants nous proposent une visite guidée de l'occupation. Une table avec des collations et du café accueille les nouveaux venus. Des affiches peintes à la main sont collées aux murs. Nous les suivons dans les couloirs où une ligne du temps reprenant l’histoire du conflit rythme les marches d’escalier.
«L’occupation a démarré par une manifestation sur l'avenue Paul Héger, puis elle s’est déplacée vers le bâtiment U», nous indique un des guides, alors que nous passons devant un dortoir où des sacs de couchage vides patientent en silence. «La sécurité a fait son travail, nous avons fait notre devoir», plaisante le deuxième.
Croisé devant le bâtiment, concentré sur un yaourt offert par une association en soutien à l’occupation, un agent de sécurité nous donne l’occasion de prendre le pouls de la situation: «Oui, tout se déroule bien, les jeunes nous respectent et échangent dans le calme. Je n’ai pas connaissance de débordements. Ceux que je crains, ce sont les militants d’extrême droite qui peuvent se montrer violents». Une inquiétude qui sera confirmée par un occupant racontant avoir écopé en pleine nuit «de tirs de mortier, dirigés vers un groupe de personnes alors qu’elles discutaient sur la terrasse».
Après un rapide tour du propriétaire, nous rencontrons un étudiant chargé de la communication avec la presse, qui a accepté de faire une pause dans sa journée de blocus collectif, organisé dans une salle du bâtiment Walid Daqqa. «Le mouvement est né d’une impulsion étudiante face au génocide en cours en Palestine et à l’inaction des autorités académiques», commence à nous expliquer cet étudiant en philosophie, passionné par la pensée de Gilles Deleuze. «Bien qu’issue d’une pluralité de traditions politiques, notre moteur est la discussion: nous sommes à la recherche de la démocratie la plus horizontale.»
Cette modalité de gouvernance sera illustrée quelques jours plus tard, lors des négociations avec le rectorat. L’échange commence avec le refus catégorique de la rectrice d’être filmée. Les étudiant·es, après avoir rappelé que les négociations se dérouleront selon leur propre convenance, proposent de s’en remettre à l’avis de la majorité. Collégialement, la salle décide de ne pas autoriser la captation des négociations…
En deçà du rapport de force affirmé par les militant·es, c’est l’horizontalité démocratique qui impose ses conditions. «Je suis très impressionné par l’organisation de ces étudiants, approuvera par la suite une personne issue du milieu académique, c’est la première fois que je vois un mouvement étudiant avec une forme aussi inclusive et démocratique. Certain·es étudiant·es apprendront plus de ces semaines d’occupation qu’avec cinq années d’études.»
Suspension des partenariats académiques
D’après un communiqué de presse de l’Organisation des Nations unies (ONU) publié le 18 avril dernier, en six mois de guerre, 5479 étudiant·es, 261 enseignant·es et 95 professeur·es d’université ont été tué·es à Gaza. Toujours selon ce rapport rédigé par un consortium international, 80 % des établissements scolaires de Gaza ont été endommagés ou détruits2
. «Le centre de nos revendications est de suspendre tous les partenariats académiques avec des université complices du génocide», nous explique le militant chargé de la communication du mouvement.
Pour comprendre le rôle que peuvent jouer les universités israéliennes dans la guerre, la chercheuse Maya Wind travaille sur leur lien historique: «Le développement de l’enseignement supérieur israélien a été étroitement lié à l’essor des industries militaires israéliennes, que les universités israéliennes continuent de soutenir.» C’est en s’appuyant sur ces constats, étayés dans son ouvrage Tour d’Ivoire et d’acier, que des étudiant·es du monde entier ont pris part aux occupations en exigeant de leur université le boycott académique: «À l’université, le savoir, c’est notre pouvoir. La question, c’est comment l’utiliser. C’est pour cette raison que nous demandons le boycott académique. Et le corps professoral se positionne de plus en plus en faveur à notre mouvement», termine, optimiste, le futur philosophe, avant de retourner à ses syllabus.
La communauté universitaire divisée
Un sondage mené en décembre dernier auprès de 936 universitaires spécialistes du Moyen-Orient indique que 82% des personnes interrogées et 98% des professeur·es non titulaires affirment s’autocensurer sur la question israélo-palestinienne depuis l’attentat du 7 octobre3
. «Depuis huit mois, il règne un silence hallucinant au sein du monde académique», nous confie un professeur qui désire conserver l’anonymat. «Maintenant, la majorité des académiciens critique le mouvement en lui reprochant sa radicalité et son antisémitisme. Ce sont des bruits qui passent à côté du problème.»
Une autre source du monde universitaire critique l’idée selon laquelle la difficulté du débat entrave la parole de ses collègues: «Il faut déconstruire l’idée de la complexité à se positionner sur le sujet. Elle sert d’étendard à l’attentisme, qui est la forme savante du laisser-faire. Rendre la question palestinienne complexe fait partie de l’argumentaire de l’État israélien. Les autorités des universités mobilisent également cet argument pour délégitimer les mobilisations étudiantes.»
Pourtant, les universitaires interrogé·es insistent sur le fait que depuis l’occupation, de plus en plus de professeur·es commencent à s’impliquer. Un chercheur tempère: «La Belgique a une part d’exemplarité vis-à-vis d’autres universités chez des pays voisins: même si elles ne le crient pas encore, certaines sont déjà en train de boycotter Israël». Comme le clamait avec verve un militant, citant à la tribune de l’Assemblée générale de l’Université populaire de Bruxelles un discours de Victor Hugo, «tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli». Le lundi 27 mai, un communiqué de l’ULB, publié à la suite du Conseil académique, annonçait «la suspension des accords et projets institutionnels de recherche impliquant une université israélienne4
».