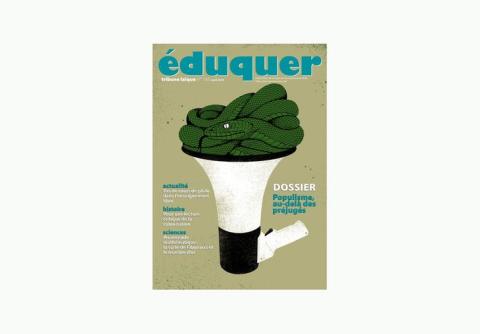Le populisme ressemble aujourd’hui à un inventaire à la Prévert, la poésie en moins. Chirac, Berlusconi, Sarkozy, Tapie, Cresson, Chavez, Le Pen, Haider, Fortuyn, Bové, Lula, Mélenchon ont été rejoints par Orban, Salvini, Corbyn, Trump,
Kaczynski, Strache, Iglesias dans la longue et multicolore liste des populistes. Nous verrons que l’utilisation du terme aujourd’hui vise surtout à discréditer le peuple, face à une «élite éclairée».
En France quand son usage s’impose dans les années 1990, le mot renvoie au Front national considéré comme un «appel au peuple» rassemblant des «mécontents» dressés contre les élites établies et séduits par le charisme de JeanMarie Le Pen, la magie de son verbe et ses idées xénophobes. Depuis, succès oblige peut-être, son emploi s’est propagé tel un «virus» ou une «épidémie» selon le lexique pathologique en cours à propos des partis auxquels il est censé renvoyer; il désigne aussi bien les extrêmes droites que les gauches, encourage les papiers sensationnels («Mélenchon-Le Pen: le match des populismes»), les prises de position indignées, les colloques, articles, ouvrages donnant dans la comparaison internationale et appelant à la réaction de l’Union européenne.
Disqualifier «l’autre»
Il attise surtout l’inquiétude pour la démocratie et la suspicion à l’égard des classes populaires, notamment sur leur prédilection supposée pour les hommes politiques aux idées courtes et au racisme affiché. Prétendant expliquer, le mot disqualifie ainsi d’emblée en rendant infréquentables ceux et celles qu’il caractérise; il autorise alors le renvoi au rang des notions vintage le clivage droite/gauche au profit d’un nouveau distinguant les gens raisonnables, ouverts, progressistes, des radicaux, nationalistes, fermés (songeons aux discours de Merkel ou Macron), tous les «incompatibles» du fait de leurs «valeurs» et leurs «attitudes» avec la démocratie et le progrès (ainsi que l’affirmait un think tank lié au parti socialiste). Le mouvement des «gilets jaunes» fait aujourd’hui les frais d’une telle stigmatisation et donne involontairement du crédit à de tels jugements. Mais le plus étonnant sans doute dans ces usages intempestifs d’un tel label «chamallow» est l’étroite imbrication de la lutte politique et des controverses apparemment savantes. Historiens, philosophes, politistes se mobilisent et prennent explicitement position pour ou contre l’existence d’un populisme de gauche, la filiation populisme-fascisme, l’instauration de «démocraties illibérales» (comme en Pologne, en Hongrie)… Sociologiquement que faire? Retracer l’histoire du mot en révèle l’étrange voyage et les préjugés trompeurs qui l’alimentent.
Une signification actuelle qui renvoie aux années 80
Les entreprises en filiation ont tort de faire remonter l’origine du populisme aux premières expériences politiques du début du XXe siècle qui s’en revendiquaient (populistes russes, People’s Party américain) pour en suivre ensuite logiquement les autres destinations (les régimes latino-américains comme celui de Péron en Argentine, par exemple). Sa signification actuelle est très récente et politiquement située et elle a créé une véritable rupture avec les usages qui la précédaient. Elle vient des débats animant, à la fin des années 1970, l’extrême droite américaine cherchant à se démarquer des libéraux (recrutés dans la grande bourgeoisie WASP) en se qualifiant elle-même de populiste. Nul «appel au peuple» ou sensibilité populaire ici: simple usage cynique du peuple pour conférer un semblant d’éthique philanthropique à une entreprise ultra conservatrice sur le plan économique et politique. C’est cette fiction intéressée qui est importée en France dans les années 1980 pour désigner le FN. Il s’agit alors, pour ses nouveaux utilisateurs (philosophes, historien·ne·s surtout), de se distinguer des commentaires alors dominants, voyant dans ce parti, apparu à la stupeur générale sur la scène politique nationale, un fascisme ou une extrême droite en lui inventant une nouvelle identité: le FN ne serait qu’une nouvelle droite, certes un peu radicale, mais peu dangereuse et surtout une droite populaire. Ainsi un faux-semblant est pris pour la réalité de ce parti sans autre preuve que sa réussite électorale inopinée. Peu plausible les premiers temps, la fiction gagne son (pauvre) réalisme quand, à partir des années 1990, des politologues découvrent, sur la foi des sondages électoraux, un «fait» extraordinaire: ce seraient les classes populaires (ouvrier·e·s, employé·e·s, chômeur/euse·s) qui voteraient Le Pen. Que cette affirmation reçoive de multiples démentis n’empêche rien. La boucle est bouclée, le mot a trouvé sa recette.
Un racisme social
Le «populisme» attire d’abord le populaire, son étymologie ne renvoie-t-elle pas d’ailleurs au «peuple»? Rien d’étonnant d’ailleurs à ce qu’un parti indigne subjugue surtout les fractions sociales les plus illégitimes socialement: par manque de ressources culturelles et économiques, elles ont une crédulité réceptive aux thèses frustres et simplistes du FN, à l’inverse des plus éduqués et des plus riches protégés par leur culture de toute adhésion à des idées xénophobes ou intolérantes. Le FN devient alors le premier parti ouvrier en France et le substitut du parti communiste. Que dire? Sinon que cette «évidence» confond analyse et préjugés et que, mêlant injure et explication, elle lève des censures ouvrant sur l’affichage sans fard d’un racisme social sous l’apparence de constats «simplement» descriptifs? «Qui a inventé les termes de bougnoules si ce n’est les classes populaires?» s’interrogeait plaisamment par exemple un politologue réputé en 2005 lorsque les catégories populaires, au grand scandale des «élites éclairées», ont voté «Non» au référendum européen.
Le peuple ennemi de la démocratie
Les usages du «populisme» ignorent droite et gauche, amalgament des partis aux pratiques et idéologies opposées, confèrent à un parti indigne politiquement et moralement une identité bien moins injurieuse que ses précédentes appellations (ce que le FN va s’empresser de reprendre à son compte à partir du milieu des années 1990 en se déclarant «populiste d’abord»). Ils brouillent également les notions de peuple et de populaire et font opérer au mot lui-même une complète révolution idéologique entre hier et aujourd’hui. En effet, longtemps absent du vocabulaire public de la polémique politique où lui étaient préférés des termes comme «démagogie» ou «poujadisme», le «populisme» servait, selon la définition de Lénine, à dénoncer une stratégie dévoyée de mobilisation du peuple contre ses propres intérêts et contre ses principaux défenseurs. S’il stigmatisait, c’était ainsi moins pour insister sur la dangerosité d’une mobilisation politique «directe» du peuple que sur le danger que représentaient pour le peuple des prétentions à le défendre venues d’intellectuels ou d’hommes politiques ne faisant que projeter sur lui leurs propres aspirations et leurs propres intérêts. En désignant maintenant le FN (ou d’autres extrêmes-droites), le mot change de perspectives. Le danger n’est plus dans le jeu des élites; il est dans les groupes populaires qui, xénophobes et incultes, ne cessent de se rallier à des causes détestables et de démontrer ainsi leurs indispositions pour la démocratie. Le populaire hier valorisé est aujourd’hui disqualifié au point d’être passé du statut de cause à défendre à celui de seul vrai «problème» pour la démocratie. A l’inverse, les élites sociales en ressortent toutes auréolées de supériorité morale (même si les scandales à répétition ébranlent un peu celle-ci ces derniers temps…). La distance morale alors créée avec les plus démunis est telle que, pour les uns, elle justifie tous les abandons passés et futurs quand, pour les autres, elle incite à la récupération bruyante d’un peuple enfin réduit à leur propre image: «sans classe» et sans éthique politique.
Un terme qui disculpe les élites
Mot cynique, injurieux, le «populisme» est triplement trompeur. Sur les partis qu’il désigne, bien moins sensibles idéologiquement aux classes populaires que défenseurs de politiques qui leur sont contraires. Sur le clivage libéraux/populistes comme si n’existaient plus ni droite ni gauche, ni domination sociale et politique, et que les appétences autoritaires ne concernaient que les seconds et épargnaient les premiers. Sur ce qui menace réellement la démocratie enfin. En classant les élites sociales à l’écart du «populisme», le mot les exonère du retournement autoritaire que connaît la démocratie dans ses règles pratiques et juridiques; elle les disculpe de la montée des intolérances et des inégalités dont témoignent les politiques mises en œuvre: contrôle des «mauvais pauvres», licenciements à la pelle, fermeture d’usines qui font pourtant des bénéfices, maltraitance des populations «migrantes» toujours vues comme délinquantes, chasse aux enfants autour des écoles, criminalisation de leurs défenseurs syndicaux, associatifs,… Rien n’interdit pourtant de penser que le destin de la démocratie se joue là, dans le cours ordinaire de la compétition et des décisions politiques des acteurs centraux, et non lors des élections ou de la montée «d’extrêmes».
Annie Collovald, Professeure de sociologie politique à l’université de Nanterre, ISP Annie Collovald est Professeure de sociologie politique à l’université de Nanterre et l’auteure de «Le populisme du FN»: un dangereux contresens (Bellecombes-en-Bauge, Le Croquant, 2004).