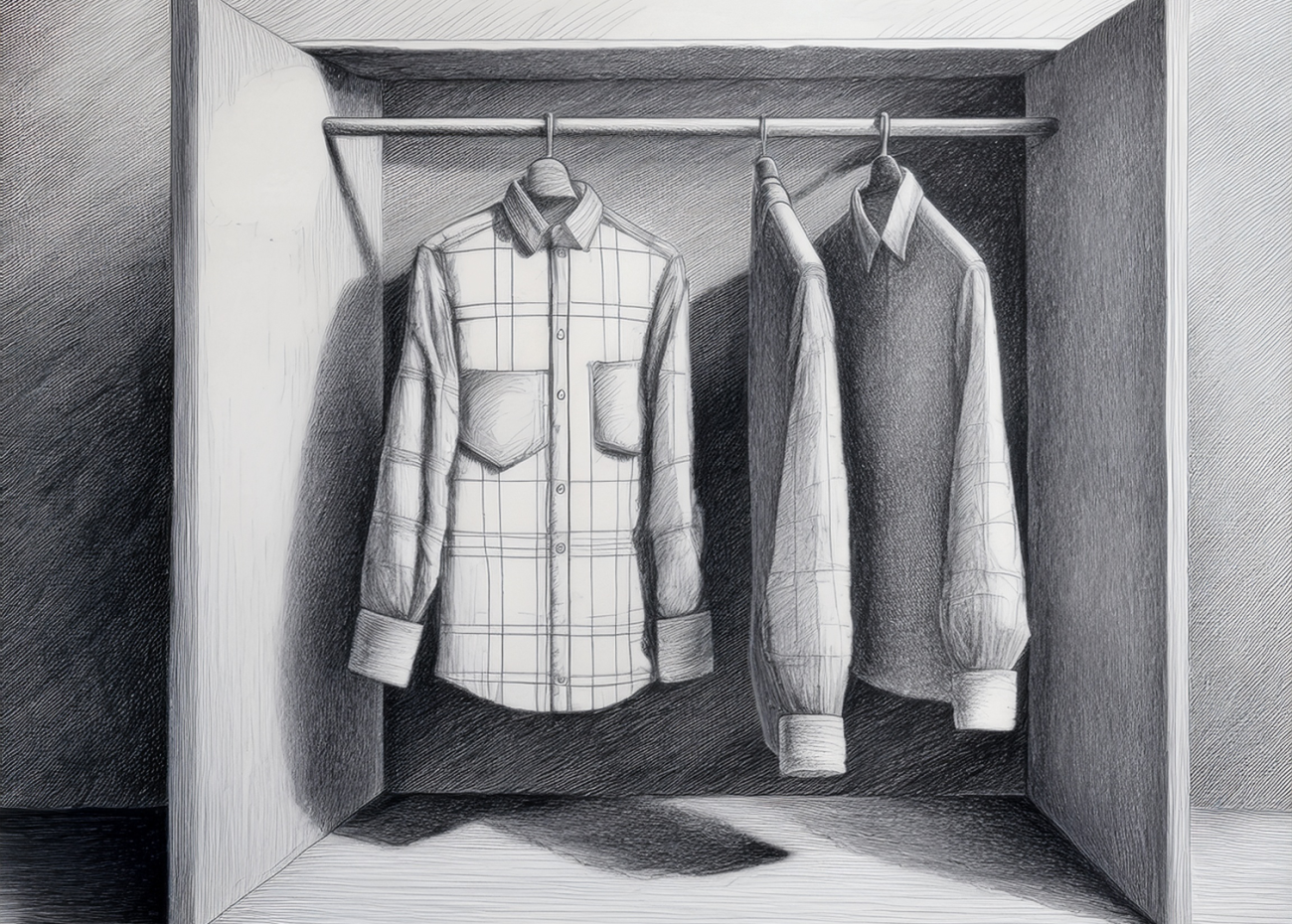
Depuis son retour au pouvoir en 2010, Viktor Orbán orchestre une politique scolaire d’extrême droite. Bien que distant de 1500 kilomètres de la Belgique, son virage autoritaire sonne comme un avertissement pour l'Europe entière.
«Le plus grand péché de la politique de Viktor Orbán, c’est la destruction de l’enseignement public», entame Orsolya Erőss depuis son bureau à Budapest. Cette enseignante de français langue étrangère exerce dans un lycée hongrois depuis 21 ans. «La vie des professeurs et de leurs élèves devient de plus en plus réglementée. Notre autonomie professionnelle se réduit à peau de chagrin: nous nous sentons ligotés.» Seules ses convictions la maintiennent dans un métier qu'elle a vu se déliter: dégradation des conditions de travail, baisse des salaires, suppression du marché libre des manuels et pénurie croissante d'enseignant·es.
«Enseigner sous Orbán, c’est vivre la honte au quotidien. Le niveau des élèves est alarmant. Le système scolaire hongrois fabrique des individus obéissants.»
Vivre la honte au quotidien
«Certaines capacités physiques et intellectuelles sont différentes chez les filles et les garçons» est l'un des principes que peuvent apprendre les élèves hongrois au cours de biologie. En limitant le choix des manuels, la politique scolaire de Viktor Orbán entend imposer sa vision de la société: un récit national révisionniste, une homophobie assumée et une défense acharnée de l'Occident chrétien.
«Enseigner sous Orbán, c’est vivre la honte au quotidien. Le niveau des élèves est alarmant. Le système scolaire hongrois fabrique des individus obéissants», soupire Zsuzsanna Pócsné Berkesi. Jointe par visioconférence pendant sa pause déjeuner, celle qui enseigne dans un lycée du 3e arrondissement de Budapest illustre son propos par la caricature: ses élèves feraient des galipettes sans poser la moindre question si elle le demandait! Comme sa compatriote, l’enseignante confie souvent hésiter à quitter la profession: «Mais en partant, punirais-je le gouvernement ou mes élèves?»
Du contrôle sans interrogations
Pourquoi quitter ce qu’elle nous décrira plusieurs fois être sa vocation? «L’impact de la politique d’Orbán, c’est le contrôle absolu.» Zsuzsanna le démontre à travers les problèmes rencontrés avec son ancienne direction à la suite d'un post publié sur Facebook: quelques lignes de réflexions sur la programmation d'un poète nationaliste et homophobe du XIXe siècle lui coûtèrent son poste. Dans un autre établissement, ce furent de présumés parents d'élèves qui s'offusquèrent d'avoir retrouvé le terme «manifestation» dans le cahier de leur enfant.
L’enseignante cite aussi l'ambiguïté de la plateforme en ligne Kréta. Signifiant «craie» en français, elle est devenue le symbole d'une surveillance constante: les enseignant·es sont contraint·es d’y compiler virtuellement leurs cours et les présences des élèves. Si elle s'avère pratique à certains égards, cette plateforme est également un instrument de contrôle, pouvant à tout moment être consultée par l'administration.
Le démantèlement de l'enseignement public
Cette mainmise idéologique s'est accompagnée d'une réduction conséquente des budgets alloués à l'éducation. La Hongrie y consacre en effet l’un des pires budgets de l'OCDE et cette situation couve un record d’inégalités scolaires: lors des derniers tests PISA, le pays obtenait la deuxième plus grande différence de scores selon l’origine socioéconomique des élèves. Alors que l’obligation scolaire a été abaissée à 16 ans, les filières professionnelles réduisent les cours généraux. En outre, le financement avantageux des écoles confessionnelles accentue ces inégalités. Selon l'association hongroise «La voix des parents», trois fois plus d'argent serait investi dans les écoles religieuses que dans les établissements publics. À cela s’ajoute une forme d’organisation scolaire ségrégationniste qui touche la population tzigane, souvent placée dans des classes distinctes. «La ségrégation religieuse, raciale et sociale, voilà la dimension d’extrême droite en Hongrie», résume Orsolya Erőss.
La précarité des salles de classe est séparée par un fin couloir de celle de la salle des profs. Alors que l’inflation galope, le salaire mensuel moyen stagne autour des 400.000 forints, soit environ 1000 euros. «Certains dispensent des cours privés en dehors de leur horaire, tandis que d'autres font des ménages pour payer leur loyer», confie Zsuzsanna Pócsné Berkesi. L'une de ses compatriotes nous explique ne pas connaître de collègues «qui ne travaillent pas à côté». Une autre nous révèle son salaire net: 1470 euros mensuels, malgré ses 33 années d’ancienneté.
Depuis janvier 2024, les enseignant·es ont perdu leur statut de fonctionnaire. Ce nivellement implique davantage d'obligations, pour moins de libertés. Orsolya Erőss décrit des rentrées scolaires kafkaïennes, chaque nouvelle année étant plus absurde que les précédentes. «Il y a de plus en plus en plus de tâches administratives. Nous avons l’impression d’avoir de moins en moins de temps pour l’enseignement.» Et pourtant, depuis 2013, les horaires hebdomadaires ont été élargis de 18 à 32 heures. Visant à aplanir la pénurie touchant la profession, cette réforme n’a fait que l’accentuer. Ces mesures se sont installées progressivement, comme l’on dilue du poison dans l’eau. Une enseignante recourt à la métaphore des grenouilles plongées dans une casserole d’eau froide et progressivement réchauffées, jusqu’à finir ébouillantées…
Les risques d’une décentralisation dérégulée
Après un premier mandat à la tête de la Hongrie entre 1998 et 2002, Viktor Orbán (parti Fidesz, extrême droite) reconquiert le poste de Premier ministre en 2010. Cette deuxième séquence ouvre une profonde réorientation de la politique scolaire hongroise. Iván Bajomi, professeur émérite en sociologie de l'éducation à l'université hongroise, y décèle un retour à une conception du XVIIIe siècle, quand l’enseignement était un instrument de construction nationale.
L’expert contextualise: «Dès 1985, avant même la chute du bloc soviétique, la Hongrie amorçait déjà une décentralisation de son éducation. Après 1990, le paysage scolaire s'est transformé avec l'émergence de nouveaux acteurs influents: les syndicats et les associations professionnelles. Les municipalités deviennent propriétaires des écoles. C’est une période de diversification de l'offre éducative. La politique éducative encourage l'apparition d'écoles privées alternatives.»
Cette décentralisation de l'administration s'est accompagnée d'un système de subventionnement des municipalités, calculé au prorata du nombre d’élèves scolarisés dans ses différents établissements scolaires. En période de déclin démographique et de baisse du budget éducatif, l'absence de conditionnement géographique à l'inscription des élèves a dérégulé la concurrence entre établissements. Spécialiste des sciences de l'éducation à Cergy Paris Université, Jean-Pierre Véran y voit le franchissement d'une ligne rouge entérinant «une véritable défaillance du service public au sens où le système éducatif ne garantit plus l'égalité des usagers dans ses principes ».
«L’enseignement est un bon exemple de ce nouveau rapport du pouvoir avec les citoyens. Orbán crée des pyramides où il est à la tête et supprime l’autonomie des institutions.»
Résistance et répression
C’est d’un service public érodé qu’hérite Orbán à son retour aux affaires en 2010. Des conditions qui rendent possible le virage autoritaire du système éducatif, avec le démantèlement des instances consultatives récemment créées et la suppression de l'autonomie des écoles communales. Iván Bajomi appuie: «Toutes les décisions, matérielles et pédagogiques nécessitent l’approbation de l’administration. Les écoles redeviennent assujetties aux intentions du centre.»
Le «coup d’État constitutionnel» entériné par le chef d’État connait ainsi son pendant éducatif. Le ministère de l'Éducation a été supprimé, réduit à un secrétariat d'État rattaché au ministère des Ressources humaines, avant de passer en 2022 sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Dirigé par l’ancien policier Sándor Pintér, le ministère entend «faire de l'ordre dans l'enseignement» avec des sanctions plus sévères, comme le licenciement.
Enseignante de français subitement licenciée en 2022 pour des raisons politiques, Kata Törley témoigne: «L’enseignement est un bon exemple de ce nouveau rapport du pouvoir avec les citoyens. Orbán crée des pyramides où il est à la tête et supprime l’autonomie des institutions. Il a fait d’un système scolaire relativement décentralisé un système scolaire totalement centralisé.» De passage à Bruxelles, elle nous donne rendez-vous au Parvis Saint-Pierre à Uccle, à plus de 1350 kilomètres de son ancienne école. Après avoir choisi un café à la crème au lait russe, elle évoque son quotidien, qu’elle conjugue désormais à l’imparfait: «Budget, programmes, manuels: tout était piloté depuis le centre. Cela impliquait également la perte d’autonomie des enseignants en tant qu’individus. Les moindres choses manquaient: les directeurs ne pouvaient même plus commander une ampoule. C’est là que notre mouvement s’est lancé.»
C’est en 2016 que craquent les dernières digues. Sous une pluie battante, plusieurs centaines de manifestants se retrouvent devant le Parlement de Budapest. Les parapluies en deviendront les symboles officieux. Kata Törley y prend un rôle de porte-parole: «Ce mouvement dépassait le monde éducatif, il cristallisait une opposition générale à la politique de Viktor Orbán.» Ces manifestations rassemblent de nombreuses personnes, et ce malgré la méfiance envers le syndicalisme, héritée de l’époque soviétique. Le pouvoir est peu habitué à ces formes de revendications. Un ministre qualifie ces manifestant·es de «gens peu sérieux, hirsutes et vêtus de chemises à carreaux». Les enseignant·es retourneront le stigmate en érigeant les chemises à carreaux comme symbole de la contestation. Plus récemment, une autre réponse adoptée par le gouvernement fut l’inauguration d’une Faculté de formation des enseignants, axée sur les valeurs nationales. «Je pense qu’un des objectifs non avoués de cette formation est de mettre fin aux contestations», suggère Iván Bajomi.
De la grève mutilée à la désobéissance civile
Après la pandémie, la pénurie d’enseignant·es s’aggrave. En cinq ans, les postes non pourvus sont passés de 7.000 à 35.000. Alors qu’un poste sur dix est vacant, les départs se multiplient tandis que les recrutements diminuent. Le corps enseignant est vieillissant: l’âge moyen des professeurs est de 50 ans. Dans certaines disciplines, en particulier les matières scientifiques, le renouvellement est inexistant. Et les difficultés s’alimentent: le manque de personnel dégrade les conditions de travail, cette déliquescence repousse les jeunes de la profession.
Fin 2021, après l'échec des négociations avec le gouvernement, les syndicats lancent une grève. Qualifiée d’illégale par le gouvernement, les tribunaux finiront par statuer dans le sens des syndicats. Le pouvoir réplique par un décret imposant des services minimums: 50% des cours doivent être maintenus et 100% pour les classes terminales. «Notre grève était mutilée», grince Kata Törley. Consterné, un collègue lui téléphone quelques jours après l’annonce. Devant cette impasse, ils décident de se tourner vers la désobéissance civile: «Nous avons commencé à organiser des grèves par rotation. Comme une avalanche, le mouvement s’est répandu dans plusieurs centaines d’écoles, avec la participation de milliers d’enseignants.»
La sentence tombe un vendredi. Des membres de l’administration s’engouffrent dans l’école et lui remettent une lettre de licenciement immédiat. L’enseignante a quelques minutes pour quitter 23 années de pratique passionnée. Une profession qu’elle continue de considérer comme sa vocation. «C’est extrêmement douloureux d’être renvoyée de son métier pour un cas de conscience», confie-t-elle au bord des larmes. À quelques tables de notre échange, des enfants commencent à hurler. Dépités, nous bredouillons une dernière question pour clôturer l’entretien sur une fin moins dramatique. «Oui, il y a aussi du beau. Nous avons touché la grâce quand enseignants, élèves et parents se sont unis pour un avenir meilleur. Le soutien est tel que je ne peux traverser les rues de Budapest sans être applaudie.»



