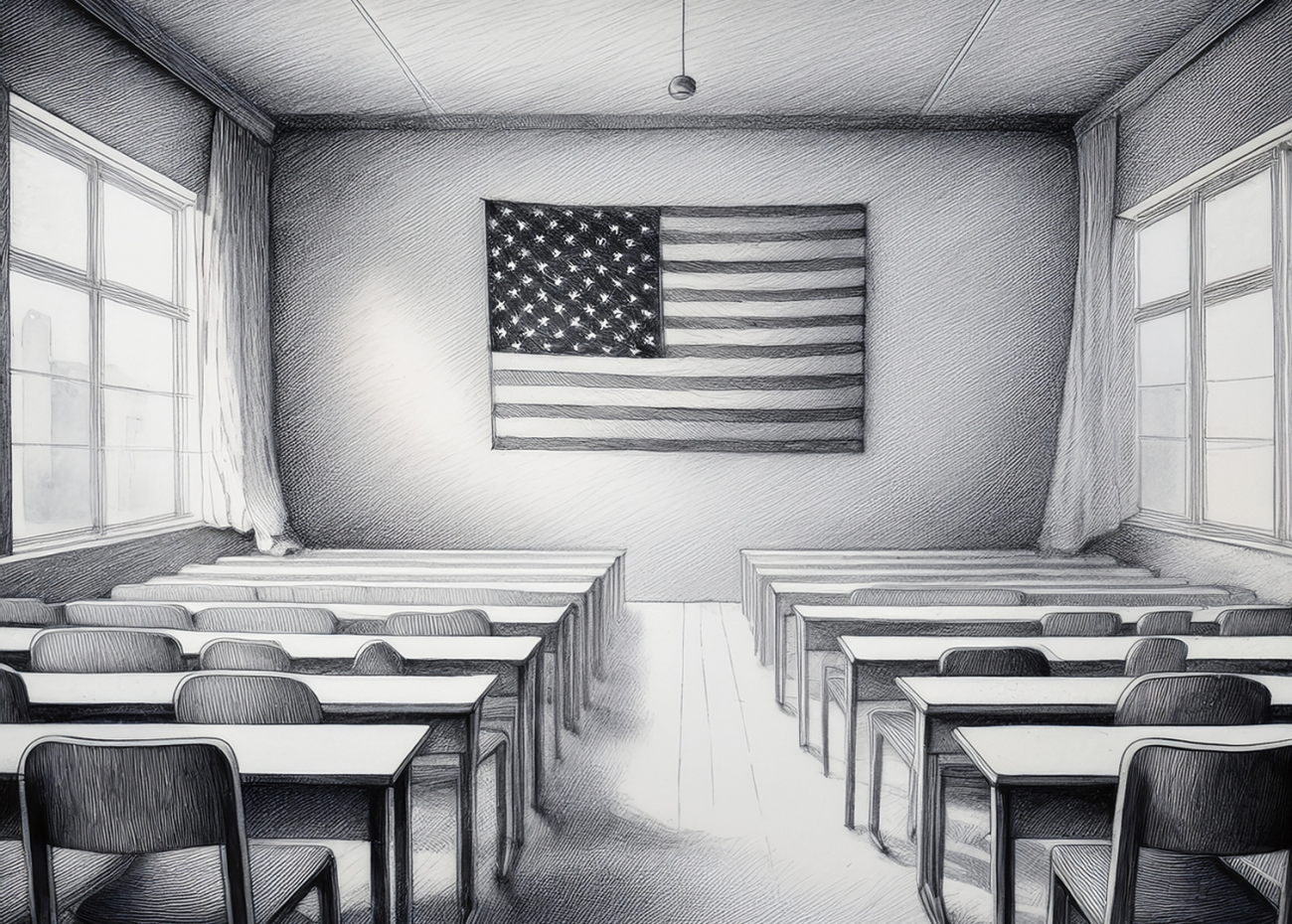
Donald Trump annonce l’abolition du département de l'Éducation. Entre guerres culturelles, financement inégalitaire et privatisation, son second mandat menace d'exacerber les disparités scolaires aux États-Unis. Un véritable cas d’école.
Chaque jour, le président étasunien Donald Trump stupéfie le monde entier: salut nazi de son conseiller Elon Musk, humiliation du président ukrainien Volodymyr Zelensky ou encore réduction de la protection de l’environnement. Le président d’extrême droite s'attaque désormais au système éducatif, en licenciant la moitié du personnel du département de l’Éducation, avec le projet assumé de son abolition. Un programme rappelant les tentatives de Ronald Reagan dans les années 1980, mais qui pourrait cette fois aboutir.
Un projet de privatisation
Lors de son premier mandat, Donald Trump avait confié le département de l'Éducation à la milliardaire Betsy DeVos. Cette fervente partisane d'une privatisation intégrale du système éducatif rêvait de voir les écoles transformées par l'innovation, pour développer les «équivalents éducatifs de Google, Facebook, Amazon, PayPal, Wikipédia ou Uber». Un projet messianique, auréolé de l’ambition de «faire avancer le royaume de Dieu».
Si cette réforme n'avait pu être pleinement réalisée à l’époque en raison de l'obstruction des démocrates au Sénat, l’écrasante victoire du républicain en 2024 a fait sauter ce garde-fou. Issue du secteur privé, sa nouvelle ministre de l'Éducation Linda McMahon incarne sa vision: l'école est désormais prise pour un business comme les autres. L’abolition de ce département entrainerait une coupure d’un dixième d’un système éducatif déjà largement mutilé. Une hémorragie que le président a prévu de soigner à coup de privatisation des écoles. Sous ce second mandat, le corps enseignant étasunien va-t-il passer du purgatoire à l'enfer?
«Les guerres culturelles ne reposent pas sur de simples différences d'opinions politiques, mais sur des conflits de valeurs, ce qui rend impossible tout compromis entre les deux camps.»
L’éducation comme stratégie politique
Après l’échec à sa réélection en 2020 et l'opprobre suscité par la tentative d'insurrection du Capitole, Donald Trump a relancé sa dynamique politique en mobilisant son électorat autour des «guerres culturelles». Alors que l’éducation n’était pas sa priorité lors de son premier passage à la Maison-Blanche, l’enseignement de la théorie critique de la race et la question de l'identité de genre sont devenus pour lui des obsessions. Une propagande s'est déployée dans les médias conservateurs, accusant les enseignant·es qui abordent les questions de sexualité dans les classes de grooming (terme désignant les prétendus efforts d’un adulte pour modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'un·e mineur·e). Cette panique morale, alimentée par des groupes chrétiens conservateurs (évangéliques et catholiques), les think tanks conservateurs et la droite radicale, véhicule l'argument que les enfants seraient préparés aux abus sexuels.
Des groupes de parents conservateurs ont investi les pouvoirs locaux afin d’influer sur les politiques éducatives. Selon une enquête relayée par le New York Times, «au cours de l'année scolaire 2023-2024, plus de 10.000 titres de livres ont été retirés des écoles publiques du “pays de la liberté”». Une série de lois ont été adoptées par des États républicains pour censurer l'enseignement des questions liées à la sexualité. Durant la présidence démocrate de Joe Biden (2021-2025), le parti républicain a donc réussi à s'imposer dans le débat public en se concentrant sur la politique locale et en mobilisant sa base militante autour des guerres culturelles.
Spécialiste des questions de genre, le doctorant en sciences de l'éducation Olivier Berton décrypte ce phénomène: «Les guerres culturelles actuelles correspondent à une compétition entre deux systèmes de compréhension morale du monde, pour reprendre les termes du sociologue James Davison Hunter, qui a forgé cette notion au début des années 1990. Elles ne reposent pas sur de simples différences d'opinions politiques, mais sur des conflits de valeurs, ce qui rend impossible tout compromis entre les deux camps.»
Au pays des guerres culturelles
Le chercheur replace ce conflit dans la généalogie des guerres culturelles portant sur l'école publique américaine. En remontant aux années 1920, les prémisses de ce clivage idéologique suivent deux trajectoires qui parfois se recoupent: l'inclusion des minorités dans l'enseignement de l'histoire et les questions religieuses. Depuis le milieu des années 2010, les tensions autour des questions raciales se sont accentuées. Les conservateurs accusent l'enseignement de l'histoire de véhiculer l'idée que les Américains blancs sont, de façon inhérente, des oppresseurs.
«Les médias conservateurs affirment que la théorie critique de la race, selon laquelle le racisme ne repose pas uniquement sur les préjugés des individus mais sur des inégalités structurelles au sein des institutions, serait enseignée de façon massive dans les établissements scolaires. Or cette allégation a été démentie par des enquêtes récentes et participe au travail de désinformation du mouvement trumpiste», précise Olivier Berton.
Depuis 2020, presque la moitié des États ont adopté des lois anti-CRT (Critical Race Theory). Leur formulation sibylline pousse les enseignant·es à se tenir sur leurs gardes au moment d’aborder les questions de racisme en classe, craignant que certain·es élèves ne se plaignent d'être stigmatisé·es en raison de leur «race», ce qui conduit à une forme d'autocensure.
Avant d’entamer sa thèse sur l’inclusion des problématiques de sexualité et de genre dans l’histoire scolaire étasunienne, Olivier Berton enseignait dans un établissement franco-américain en Californie. Il témoigne pour ses ancien·nes collègues: «Bien que la situation varie considérablement d’un État à un autre, de nombreux enseignants appréhendent les réactions possiblement hostiles de parents d'élèves. De plus, il règne un sentiment de dévalorisation sociale dans la profession. Depuis la Grande Récession de 2008, il y a eu une baisse des budgets alloués à l’éducation dans de nombreux États et, en conséquence, les conditions de travail des enseignants n’ont cessé de se détériorer.»
Une politique locale: les districts scolaires
Pour comprendre l’ancrage local de ces guerres culturelles, un détour par le fonctionnement du système scolaire permet de leur donner du volume. «Les États-Unis peuvent se penser comme un millefeuille», suggère Nora Nafaa, chargée de recherche CNRS à l’université d’Aix-Marseille. Autrice d’une thèse sur les politiques éducatives aux États-Unis, elle explique qu’au sein du système fédéral étasunien, l'éducation relève principalement de la compétence des districts scolaires. Ces plus de 14.000 gouvernements locaux définissent les grands axes de leurs établissements scolaires: programmes, équipes éducatives et salaires.
«Trump peut agir uniquement sur les programmes fédéraux, le reste de sa politique éducative est incitative», relève la chercheuse. Elle illustre son propos par l’annonce du président d’interdire les toilettes pour les personnes transgenres dans les écoles. Ce projet ne pourra pas aboutir par la voie d’un décret fédéral, cette compétence étant statuée à une échelle plus locale. Cependant, si parmi les kilomètres de décrets signés par le président, certains seront arrêtés par la douane du fédéralisme, une orientation symbolique s’est mise en route. De plus, Nora Nafaa pointe une faille dans le fédéralisme étasunien: «Le président pourrait néanmoins conditionner idéologiquement le financement de certaines aides fédérales.» Et en matière scolaire, celles-ci comptent pour 10% du budget des écoles.
Ces craintes se sont matérialisées par le décret du 29 janvier 2025 sobrement intitulé «Mettre fin à l'endoctrinement radical». Celui-ci annule le financement fédéral aux écoles publiques enseignant la théorie critique de la race ou sensibilisant à la transition de genre. Une mesure immédiatement dénoncée par Henry Giroux, figure majeure de la pédagogie critique étasunienne, comme «un instrument d’endoctrinement idéologique, imposant un récit nationaliste aseptisé qui efface l’histoire de l’oppression et de la résistance tout en renforçant une culture de l’ignorance et de l’obéissance1 ».
La fabrique fiscale des inégalités
Alors que 10% du budget d’une école publique dépend du département de l’Éducation, pour les 90% restants, la fiscalité tient une place structurante. «Dans tous les États fédérés, les écoles sont en partie financées par l’impôt foncier prélevé dans le périmètre d’un district scolaire donné. La part de ce financement dans le budget des écoles varie d’un État à l’autre. Plus un district scolaire est riche, plus ses écoles bénéficieront d’un budget élevé», nous explique Esther Cyna, docteure en histoire de l’éducation et civilisation américaines et autrice d’une thèse portant sur les inégalités liées aux financements scolaires.
L’entrelacement entre inégalités sociales et inégalités géographiques renforce les dynamiques de ghettoïsation. Pour qualifier ces effets discriminatoires, la chercheuse parle de fabrique fiscale des inégalités, qui «dépossède les populations les plus pauvres ayant le moins de pouvoir politique et tout particulièrement les populations racisées».
Entre 2019 et 2022, l’écart de richesse entre les foyers blancs et noirs est passé de 841.900 à 1,15 million de dollars, soit une hausse de 38%. Forte de son modèle de financement local, l’éducation publique est un exemple saillant de l’enjeu social de la fiscalité. Le jeu autour de la délimitation des districts scolaires, lié à la valeur de la propriété foncière, permet aux autorités locales de définir le budget alloué à leur politique scolaire.
La chercheuse souligne également le risque de voir disparaître certaines lois de protection civique, comme la loi de 1968. Dans le viseur de Donald Trump, cette loi interdit les discriminations concernant la vente et la location de logements fondées sur la race, la religion et l'origine nationale. «Si Washington décidait de la supprimer, les inégalités géographiques en seraient exacerbées: la question de l'impôt foncier, des inégalités sociales et de la ségrégation raciale ne pourrait que s'aggraver par la disparition de cette protection légale.»
Préoccupée par l’aggravation des inégalités qui s’annonce, Esther Cyna aborde le risque d’une autre mesure fiscale: «Le président soutient ouvertement les crédits d'impôt: les contribuables vont pouvoir demander d'être remboursés de leurs impôts dédiés à l'éducation afin d'inscrire leurs enfants dans des écoles privées.»
«Les écoles sont classifiées en fonction des résultats de leurs élèves à des tests standardisés. Tout ce qui n’est pas évalué est dévalorisé. L’éducation civique se trouve éjectée. C’est un danger pour la démocratie.»
À l’ouest, rien de nouveau?
Cette volonté d’alléger la fiscalité se traduit dans les écoles étasuniennes par les school vouchers. Les parents, après avoir reçu une enveloppe budgétaire pour l’éducation de leur enfant, choisissent l’établissement où ils souhaitent la dépenser. Le corollaire à ce financement direct est l’arrêt du subventionnement indirect de l’ensemble des écoles. Le chèque-éducation s’inscrit dans la logique de néolibéralisation de l’enseignement public, un chapitre de politique scolaire sur lequel s’entendent démocrates et républicains.
Experte sur le sujet, Nora Nafaa situe: «La délégation des services publics au privé s’opère également dans le cadre scolaire. C’est le cas avec le modèle des charter schools: ces établissements fonctionnent sur la base de mandats de cinq ans, au terme desquels un bilan est dressé, principalement selon des critères comptables. Les résultats conditionnent la reconduction du financement de l’école.»
En intégrant des normes managériales, ces transformations légitiment la compétition entre les établissements. L’émiettement du statut de bien commun de l’école publique se manifeste également dans la baisse de niveau de l’apprentissage, nivelé en fonction de prestations quantifiables. Interrogée sur la responsabilité de l’éducation dans la réélection du milliardaire, Esther Cyna alerte sur l’un des effets de la néolibéralisation de l’enseignement: «Les écoles sont classifiées en fonction des résultats de leurs élèves à des tests standardisés. L’accent est placé sur les disciplines présentes au sein de ces questionnaires: sciences, anglais, langues étrangères, etc. Tout ce qui n’est pas évalué est dévalorisé. L’éducation civique se trouve éjectée. C’est un danger pour la démocratie.»
En traitant l’école comme un business, l’homme d’affaires Donald Trump pourrait faire sauter d’une classe cette idéologie néfaste à l’émancipation des élèves. Et Nora Nafaa de conclure: « L'école est le reflet de la société. Certes, elle peut influer sur des trajectoires individuelles, mais pas sur les tendances économiques, sociales et politiques. De plus, l’enseignement agit sur le temps long, qui dépasse largement la durée d'un mandat. Bien qu’en théorie certaines choses puissent progresser grâce à l'école, la direction actuelle est tout autre.»
- 1GIROUX H. «Erasing History, Erasing Democracy: Trump’s Authoritarian Assault on Education», Truthout, 6 février 2025: https://truthout.org/articles/erasing-history-erasing-democracy-trumps-…



