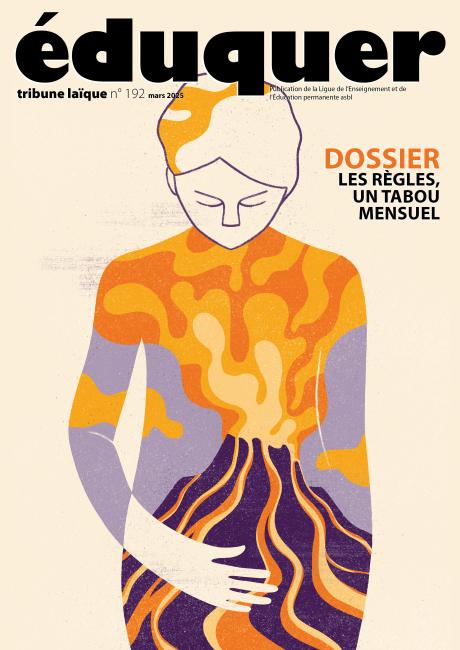Unia perd 25% de ses financements, une mesure qui inquiète autant l’institution que le monde associatif. Réduire la défense de l’égalité des chances, n’est-ce pas risquer de démultiplier les discriminations?
Versez une poignée de sel sur une plaie ouverte. Laissez mijoter les discriminations puis retirez du feu un quart de l’organisme qui se charge de les rendre visibles. Voici l’une des recettes de l’Arizona en matière de promotion de l’égalité et de l’inclusivité, sobrement déclinée dans l’Accord de coalition fédérale 2025-2029 en ces termes: «Nous diminuons le financement d’Unia avec 25%».
L'institution publique belge qui lutte contre la discrimination et promeut l'égalité voit son avenir s'assombrir. Son directeur Patrick Charlier nous énonce d’emblée les enjeux: «Cette diminution de 25% de nos financements entrave notre pouvoir d’agir envers les discriminations. Cet affaiblissement limite notre capacité d’intervention, de sensibilisation, de formation et de réactions devant ces inégalités.»
Unia, un organisme public indépendant
Derrière cet acronyme énigmatique, Unia affronte la discrimination dans toute sa diversité belge. Un combat que l'institution interfédérale mène sur plusieurs fronts: prévention, protection et promotion de l'inclusion. «Unia, c’est le porte-parole de ceux qui n’ont pas de voix», décrit Laurent Lepère, référent de l’Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES). Totalement gratuit, l’accompagnement juridique donne à ces personnes le sentiment que leurs droits sont pris en compte, même si elles n’avaient pas les moyens ou l’envie de se lancer dans de longues aventures juridiques ou institutionnelles.» Laurent Lepère aiguille vers Unia les étudiant·es confronté·es à ce qu’ils estiment être des discriminations: «Dans la jungle institutionnelle, Unia a la machette et le casque. Son personnel maîtrise les codes et le langage administratif. Cette expertise renforce leur capacité à se faire entendre par les pouvoirs publics.»
Dans un autre rayon du spectre de la discrimination, Erynn Robert, coordinateur·rice général·e de Prisme, la fédération qui regroupe des associations wallonnes œuvrant à la défense des droits des personnes LGBTQIA+, souligne l'importance de l'institution pour une société plus juste: «Unia est un partenaire essentiel dans notre travail. C’est vers eux que nous pouvons relayer les plaintes en matière d’orientation sexuelle qui nous parviennent. Dans des dossiers plus lourds comme l’année dernière à Liège lors du procès d’assise pour un meurtre homophobe, Unia s’est constituée partie civile avec nous.»
Une voix et des oreilles
Ce travail de visibilisation, Unia le mène notamment à travers la publication de rapports et d’études. Ces chiffres et ces lettres éclairent la société civile et les pouvoirs politiques sur les inégalités qui structurent le champ social. L’institution tient également un rôle dans la diffusion des actions du monde associatif, comme nous l’explique Guy Delsaut, chargé de projet à l’asbl Badje: «Unia, c’est une voix qui compte pour nous et pour de nombreux acteurs en Belgique. Nous avons l’habitude de les contacter pour avoir leur appui après la rédaction de certains de nos articles ou de nos brochures.»
En plus d’être une voix qui rend audibles les inégalités, Unia ce sont également des oreilles. Avec son numéro gratuit – 0800 12800 –, l’institution écoute, compile et traite les appels des témoins ou victimes de discriminations. En 2023, en incluant les signalements par mail, 6706 cas de discrimination étaient recensés, dont 23,8% sur les critères raciaux.
Au centre d’un enjeu régional
Les champs de vigilance d’Unia ont évolué avec la société. Le périmètre de la discrimination s'est étendu à ses formes dites «non raciales»: handicap, orientation sexuelle, âge, convictions religieuses ou philosophiques, caractéristiques physiques, etc. Fondé en 1993, le Centre pour l’Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme (rebaptisé Unia en 2016) était alors pionnier à l’échelle mondiale. Ses prérogatives portaient essentiellement sur la recherche, les recommandations politiques. Progressivement, ses compétences se sont élargies à l’action en justice.
En 2023, la Flandre se retire de l’accord de coopération avec Unia. Dans la foulée, contrainte par les directives européennes qui obligent les États à se doter d’un organe de promotion de l'égalité, elle inaugure le Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI). Néanmoins, une différence fondamentale s’introduit pendant le clonage: à l’inverse de sa grande sœur fédérale, la cadette régionale n’a pas le droit d’agir en justice. «Le VMRI peut remettre des avis, faire de la médiation, de l’information, mais n’a plus de pouvoir d’agir pour sanctionner. En Flandre, les victimes de discrimination sont moins bien protégées», résume Patrick Charlier en craignant que cette perte de dimension juridique ne se reporte sur Unia.
Après deux années d’activités, l’existence du VMRI ne peut s’expliquer à partir d’une politique de rationalisation économique. Au contraire, il s’agit plutôt d’un choix politique coûteux. Les calculs sont de Patrick Charlier: «Avant son retrait, la contribution de la Flandre aux activités d’Unia se chiffrait annuellement à 970.000 euros. Depuis sa régionalisation, l’institution flamande coûte plus de 5 millions d’euros par an au gouvernement flamand. Ce retrait coûte cinq fois plus cher qu’avant à la Flandre.»
«Diminuer de manière significative le budget des institutions qui protègent les droits humains entrainera une diminution de la protection des droits humains.»
Une décision politique
Revenons à un passé plus proche. Nous sommes fin janvier 2025 et la météo est nuageuse. Pourtant, en cherchant bien, une éclaircie s’annonce dans le ciel belge. Les présidents des partis N-VA, MR, Les Engagés, Vooruit et CD&V sont réunis à l'École royale militaire. Après huit mois d’échanges, le rythme des négociations gouvernementales s’accélère. En fin de semaine, le formateur Bart de Wever rend ses comptes auprès du Roi. Parmi les sujets épineux à l’ordre du jour figure l’avenir d’Unia. La N-VA souhaite sa suppression. Le CD&V, Vooruit et Les Engagés plaident pour la survie de l'organe fédéral. Le compromis s’acte finalement autour de la baisse de financement de 25%.
«Nous sommes dans le collimateur de la N-VA depuis une quinzaine d’années. Le projet de nous démanteler était inscrit dans le programme de la N-VA, et Bart de Wever l’a mis sur la table dès la première note de négociation en juillet 2024», avance Patrick Charlier, précisant que la réduction budgétaire ne découle pas d’un audit qui questionnerait le travail effectif de son institution. Allant dans le même sens, Martien Schotsmans, directrice de l'Institut fédéral des droits humains, nous communique que «l'accord gouvernemental ne contient aucune motivation objective à ce choix. Limiter le mandat ou diminuer de manière significative le budget des institutions qui protègent les droits humains entrainera une diminution de la protection des droits humains».
Pourquoi la N-VA souhaite-t-elle supprimer Unia?
Pour comprendre la volonté de sa suppression par la N-VA, le directeur d’Unia voit trois aspects. Il nous rappelle que Bart de Wever a exprimé à plusieurs reprises que le racisme était une notion relative. Ensuite, l’ancien président de la N-VA et nouveau Premier ministre n'approche pas la discrimination sous son angle structurel: «Bart de Wever estime que notre société offre toutes les chances à chacun, et que si quelqu’un n’a pas accès à un emploi, c’est de sa propre responsabilité. Alors que notre travail, nos études et nos recherches démontrent que les inégalités se reproduisent à travers le temps.» Un ancrage libertarien qui se retrouve également dans la conception de la liberté d’expression développée par le parti nationaliste. En inscrivant dans leur programme le souhait de supprimer le délit d’incitation à la haine, les membres de la N-VA s’opposent aux actions juridiques envers ces discours.
Enfin, rappelons si besoin le cœur du projet de l’alliance néoflamande. En plaidant pour un séparatisme de fait, la N-VA ne peut que honnir un institut interfédéral comme Unia: régi par accord de coopération, fonctionnant avec un conseil d’administration désigné par les différents parlements. Un exemple qui a de quoi déplaire aux séparatistes, comme le remarque Patrick Charlier: «Unia est un exercice de fédéralisme de collaboration qui tourne: toutes les entités collaborent entre elles pour le bien de nos missions. Ce n’est pas le modèle de société qu’envisage la N-VA, ils veulent l’indépendance de la Flandre.»
L’avenir d’Unia
Et si le travail d’Unia est aussi vaste que le sont les discriminations, l’annonce de la baisse de son financement inquiète autant le monde associatif que ses propres employés. À la suite de ses échanges avec le nouveau ministre de tutelle Rob Beenders (Vooruit), la direction nage encore dans le flou: «Nous n'avons pas encore de précisions quant au calendrier de mise en application de cette mesure. Nous ne sommes pas encore en connaissance de ses modalités de mise en pratique, progressive ou instantanée.»
Alors que 80% des dépenses de l’institution sont allouées aux frais de personnel, la base du calcul n’est pas encore totalement déterminée. Pour y faire face, plusieurs scénarios sont envisagés: des réductions linéaires dans tous les services, la restructuration éventuelle de certains services ou encore la suppression de certaines actions. Les employés en contrat à durée déterminée ont déjà été prévenus de l'éventualité de ne pas pouvoir poursuivre leur mission à l'issue de leur contrat.
L'espoir se tourne vers d’autres entités. «Nous échangeons avec le ministre Yves Coppieters pour analyser dans quelle mesure la Région wallonne et la Communauté française pourraient compenser la perte au niveau fédéral. Une manière pour nous de limiter les dégâts tout en renforçant notre présence en Wallonie», indique avec optimisme Patrick Charlier. Avant de conclure sur cet avertissement: «Si nos budgets sont limités, cela va réduire notre capacité à lutter contre les discriminations. C’est la seule certitude.»
Unia et l’enseignement

Tout en cherchant à l’améliorer, le monde scolaire est une éponge de la société. Les discriminations ne s’arrêtent pas à ses portes, mais s’y engouffrent par de nombreux orifices, démultipliés par le progrès non encadré des technologies. Comme dans d’autres champs, Unia y récolte et traite les signalements individuels de personnes qui se plaignent de différences de traitement ou de discrimination.
«De nombreux dossiers sont liés aux handicaps, à l’inclusion et aux aménagements raisonnables. Nous en ouvrons également sur des cas de discriminations raciales ou encore sur l’interdiction des signes convictionnels», informe le directeur d’Unia Patrick Charlier.
Des plaintes qu’Unia met ensuite en perspective avec le Baromètre de la diversité de l’enseignement. Façonné à partir de données chiffrées, il établit l’impact de différents critères – raciaux, de handicap, d’orientation sexuelle – sur l’inégalité au sein de l’enseignement et sur la relégation en cascade qui se joue dans les décisions des conseils de classe.
Plus d'infos: https://www.unia.be/fr/