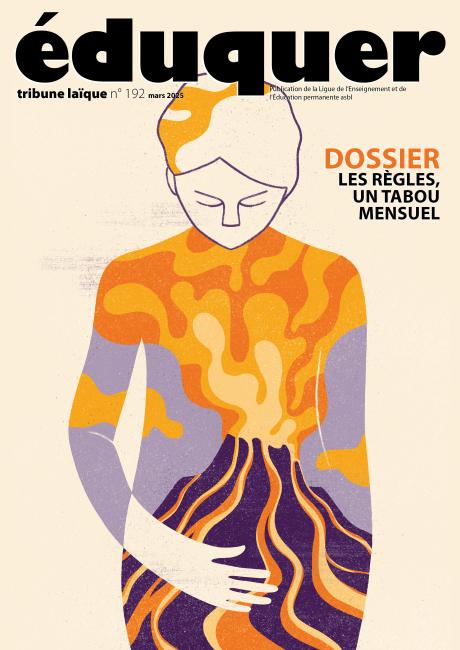Tandis que Donald Trump claironne, depuis son investiture le 20 janvier dernier, sa détermination à combattre les idées et les politiques sur le genre, la diversité et le climat, d’autres tels Orban, Melloni, Weidel ou Le Pen ne l’ont pas attendu pour s’attaquer aux libertés individuelles, dans le domaine des droits reproductifs, par exemple, ou à l’État de droit – qui recouvre la sécurité des personnes, l’égalité devant la justice, la protection contre les détentions arbitraires, l’impartialité de la justice et son indépendance.
Plus largement, c’est à la liberté d’expression et à la liberté de la presse que ces politiques s’en prennent, car elles contribuent à diffuser une vision cosmopolitique des droits humains et de la citoyenneté, opposée par ailleurs aux inégalités de genre, de race ou, plus largement, d’origine.
Plus proche de nous, c’est le président du MR, Georges-Louis Bouchez, qui entend mener une «guerre culturelle» de droite contre les idées de gauche, avec comme objectifs la conquête des cerveaux, puis celle de l’électorat.
Les notions de gauche et de droite sont relatives. Elles évoluent avec les contextes historiques, culturels et géographiques. Elles ne sont pas fixes, et ce qui était perçu hier comme de gauche a pu sembler ultérieurement de droite. Et réciproquement.
Les libertés individuelles (la liberté de conscience et de penser par exemple) ont semblé de gauche quand l’Église et les autorités religieuses prétendaient diriger les esprits, mais elles sont apparues comme étant davantage de droite quand l’égalisation des conditions et la redistribution des richesses par l’État devinrent les priorités de la gauche.
La «guerre culturelle» n’a que peu à voir avec le débat des idées et elle est souvent la prémisse de profondes fractures dans la société qui conduisent à la guerre de tous contre tous. Si elle est une facette de la politique dans sa dimension idéologique, elle contribue peu à la vie démocratique en tant que telle, quand elle ne la ronge pas de l’intérieur.
Elle est pareillement nuisible à l’éducation. Et, autant que faire se peut, elle n’a pas sa place à l’école. Car la guerre des idées, en clivant violemment les opinions, empêche de réfléchir sereinement et, dans la discussion, d’apprendre des autres.
En exacerbant les différences d’opinion, elle finit par exclure du champ scolaire les questions qui devraient justement y être abordées mais qui sont écartées car elles sont devenues des brulots froissant les convictions de chacun·e.
Patrick Hullebroeck, directeur