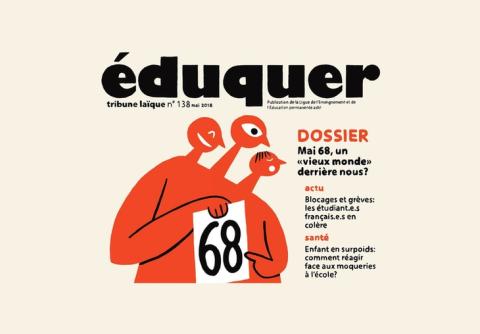«Élections piège à cons», qui fut suggéré, paraît-il par Jean-Paul Sartre lui-même, est resté comme un des symboles forts de mai 68. Un slogan qui, aujourd’hui, apparaît définitivement désuet.
Il y a quelque chose de paradoxal dans le destin de ce slogan. Quand il s’exprime dans la rue en 1968, il est en rupture manifeste avec l’imaginaire social dominant: toutes les enquêtes le montrent, à la fin des années 60, les responsables politiques (et les élu.e.s en particulier) bénéficient encore d’une forme d’autorité morale largement supérieure à celle qu’ils ont aujourd’hui. Des États-Unis à l’Europe de l’ouest, l’image de la «classe politique» n’a cessé de se dégrader depuis la fin des années soixante et est aujourd’hui à peu près proche du plancher. Et en conséquence, la désaffection pratique à l’égard du vote s’est accentuée, en même temps que le «vote d’humeur» voire, occasionnellement de «dérision». Dans le même temps, le slogan lui-même n’est plus que l’apanage de quelques cercles politiques ultra-minoritaires, proches de l’anarchie. Quoi de plus frappant en effet que de voir aujourd’hui les grands mouvements de l’opposition dite «radicale» (Syriza, Podemos, La France Insoumise, le PTB…) ou les leaders désirant «radicaliser» leur parti (Sanders, Corbyn…) chercher tous leur légitimité au sein de l’arène électorale. Il y a donc un fossé entre «Dany le rouge» - tel qu’il était il y a cinquante ans – et Pablo Iglesias, Raoul Hedebouw, Jean luc Mélenchon ou Alexis Tsipras. C’est précisément, sans doute,ce «retour au pragmatisme» qui nous sépare de mai 68. La gauche dite «radicale» d’aujourd’hui n’est pas naïve sur le suffrage universel. Elle sait que c’est une arme à double tranchant, dès sa naissance:d’une part, un outil formidable «d’empowerment» des classes populaires, auquel elles ne sont certainement pas prêtes à renoncer; mais de l’autre, une manière de «canaliser» la protestation populaire pour qu’elle reste dans les clous et n’en viennepas, qui sait, à changer radicalement l’ordre des choses. Malgré cela, la protestation de masse contemporaine, si elle commence souvent dans la rue (qu’il s’agisse des Indignados ou de Nuit debout) n’a pas cetterépulsion à s’exprimer dans les urnes qui était une des marques de fabrique des soixante-huitards. Pour comprendre cette différence, il faut distinguer les contextes et cela suppose un retour critique sur «Mai 68»lui-même.
Mai 68, une époque commune aux pays occidentaux
En France, et plus largement dans la très abondante littérature francophone interprétative, «Mai 68» nous est presque toujours présenté sous deux caractéristiques assez particulières et sans doute, au final, plutôt trompeuses. En premier lieu, c’est un «événement» dont le surgissement n’est pas expliqué ou est mis sur le compte de facteurs sociaux assez peu convaincants (crise du monde universitaire, crise de surproduction de travailleurs intellectuels…). Et en second lieu c’est un événement français dont on imagine qu’il a pu influencer ultérieurement les pays voisins (le «mai rampant» italien ou les révoltes étudiantes allemandes) mais qui n’est pas lui-même inscrit dans un contexte global. Si on s’éloigne du provincialisme français, une autre lecture est possible, qui avec le recul est peut-être plus pertinente. Mai 68, c’est l’instanciation française d’une époque commune à tous les pays occidentaux industrialisés, c’est la version française d’une révolution culturelle au sein de la jeunesse occidentale à laquelle on peut rattacher, sur un espace de dix ans, le flower power et l’anti-impérialisme des campus américains, les zengakuren japonais 1, les gauchistes allemands ou italiens, et sans doute, plus lointainement, le printemps de Prague. On peut comprendre que les interprètes français de Mai 68 ont du mal avec cette version 2 : c’est un peu comme si on banalisait «leur» Mai 68 en en faisant la «simple» version française d’un phénomène bien plus large. Ce décentrement, c’est sans doute chez un sociologue américain qu’on en trouvera la première version convaincante: Ronald Inglehart, qui écrit en 1977 «The silent Revolution »3. Etudiant en long et en large les opinions publiques au sein de l’Europe 4, et les différentiels d’opinion entre générations dans les différents pays, il arrive à rendre assez bien compte du «mouvement tellurique» dont 68 n’est qu’une explosion parmi d’autres. Si à cette époque, on voit naître, un peu partout dans le «monde occidental», des vagues de protestation sociale issues de la jeunesse scolarisée, c’est parce que cette jeunesse, qui commence à arriver à «maturité» politique précisément à la toute fin des années 60, n’a connu que la paix et la croissance économique. Après vingt années qui, l’une après l’autre semblaient confirmer l’éthos naturellement optimiste de la modernité, tout a commencé à sembler possible, surtout pour ceux qui n’ont rien connu d’autre. Dès lors, la confrontation avec les institutions, qui commence par une question parfois perçue comme anecdotique (à Nanterre, le droit de visite des étudiants masculins dans les dortoirs des filles), peut déboucher très vite sur l’espoir de «changer la vie». Cette disposition à l’égard du monde fondamentalement optimiste, Inglehart la baptise «postmatérialisme» parce qu’elle désigne ceux qui, ayant vu durant leur enfance leur besoins matériels mieux satisfaits que jamais, organisent leurs valeurs politiques davantage autour de désirs non strictement matériels. Au cœur de cette nouvelle configuration de valeurs, on trouve ce qu’on appellerait aujourd’hui la revendication de la libre disposition de soi, le refus de laisser des institutions(Eglise, Etat, École, Famille), nous dire quoi faire de nos aspirations et de nos désirs.
Un slogan utopique
Dans ce contexte «élections piège à cons» est la dénonciation de l’illusion dérisoire que ces institutions puissent réellement changer la vie et le monde. Ce n’est pas un slogan «anti-politique», c’est un slogan«utopique» au sens généreux et plein du mot: c’est l’idée que«changer la vie» cela ne se délègue pas, mais qu’il faut le faire soi-même. Cette générosité utopique,avec le recul est, en France comme ailleurs, en total contre-temps avec la nouvelle ère qui se prépare. Les trente glorieuses, qui ont produit les «postmatérialistes» sont sur le point de se terminer et le premier coup viendra avec le choc pétrolier de 1973. Enmême temps, se produit un changement, très matérialiste, celui-là: le «compromis social» de l’après-guerre est occupé à se fissurer. Le «nouveau capitalisme» remet en cause progressivement les conquêtes sociales des trente années précédentes. Les riches (re) deviennent extrêmement riches, les salariés fragiles, et les électeurs systématiquement déçus. Pour ceux qui ont cru qu’on allait «changer la vie», le dernier quart du vingtième siècle sera une longue suite de désillusions. Du coup, c’est l’ensemble de la population qui se met à se méfier des institutions et des élections: la méfiance à l’égard des «politicien.ne.s» ne fait que croître au fur et à mesure que la participation électorale s’effrite, dans pratiquement tous les pays. À l’inverse, ceux qui veulent «changer la vie» ont cessé de croire à la «spontanéité des masses». Au contraire, ils sont convaincus de l’efficacité du combat électoral lorsqu’il s’appuie sur la construction préalable d’un rapport de forces. Les héritier.e.s (lointain.e.s, et sous réserve d’inventaire) de mai 68 n’ont plus l’optimisme naturel de ceux qui croient qu’un autre monde est à portée de main. Ils ont plus simplement «l’optimisme de la volonté» selon la formule de Gramsci: la conviction que, même si rien n’est acquis, on a une chance que si on essaye. Pour ceux-là, élections piège à cons n’a plus de pertinence. Ce n’est que l’écho d’une autre époque.
Marc Jacquemain, docteur en sociologie, professeur à l’Université de Liège Docteur en sociologie.
MarcJacquemain, chargé de coursà la Faculté des sciences sociales, a été nommé professeur en 2007. Passionné par les valeurs politiques, les opinions,les attitudes, les idéologies,les identités, Marc Jacquemain pourrait être défini comme un «sociologue politique». 1. Zengakuren: fédération japonaise des associations d’autogestion étudiantes, qui, dès janvier 1968, se rendra célèbre par sa maîtrise du combat de rue contre les forcesde l’ordre. 2. Sauf peut-être Luc Boltanski et Eve Chiapello, dans Le nouvel esprit du capitalisme (NRF, 1999)dont on devine assez, quoi qu’ilss’en défendent, que leur horizondépasse le seul cas français. 3. Ronald Inglehart, The Silent Revolution, Princeton UniversityPress, 1977. Réédité en 2015. 4. Qui est alors l’Europe des six, celle des pères fondateurs. Sommaire du dossier: Mai 68 "un vieux monde derrière nous"?
Une révolte de mecs
«J’étais à Nanterre. J’ai fait mes études jusqu’en 1968 et je passais dans les couloirs du hall B. Je jetais un œil par la porte. C’était enfumé, bruyant. Il n’y avait que des garçons à la tribune mais à l’époque, c’était normal. Mai 68, c’était une révolte d’hommes, de garçons qui sont dans la domination masculine (…). Il fallait se plier aux désirs des mecs sinon on disait: ‘tu n’es pas libérée’. Parce qu’à l’époque, on commençait à prendre la pilule donc on n’avait plus peur de la grossesse. Mais ce n’est pas pour autant qu’on avait forcément envie de coucher avec tout le monde (…) 1968, on parle beaucoup de libération sexuelle et c’est vraiment abusif. Parce que c’est la libération sexuelle masculine (…). Dans les leaders, il n’y a que des hommes. On n’imagine pas une femme parmi eux. Les filles avaient un rôle subalterne. Les mecs paradaient à la tribune, les filles passaient les micros. Les mecs avaient faim, les femmes apportaient les sandwichs… Les femmes à l’époque n’avaient pas le pouvoir de la parole publique. Nos professeurs, c’était des hommes, le doyen, c’était un homme et donc les révolutionnaires, c’était aussi des hommes. Moi, je ne me sentais pas concernée.» Florence Montreynaud, historienne, sur Franceinfo, 21 mars 2018. Photo: Florence Montreynaud.
De 1968 à 2018, la culture a changé de planète
C’était il y a 50 ans, c’était semble-t-il une éternité. La tornade qui s’est élevée autour de 1968 et que l’on a longtemps considérée comme pionnière de notre culture contemporaine, ne semble plus aujourd’hui  qu’un lointain souvenir. Le monde a changé, la crise s’est durablement installée. Les intégrismes et les combats identitaires ont eu raison des utopies et de l’esprit Flower power. Plus récemment l’affaire Weinstein vient de iffler la fin de la récréation en donnant le sentiment que derrière ses slogans libérateurs («jouissez sans entraves»), la génération 68 participa d’une escroquerie intellectuelle (….) Il y a 50 ans, la Mostra de Venise célébrait le harme vénéneux de Théorème, le film de Pasolini. Une sorte de Christ fait chair entretenait des rapports sexuels avec chaque membre de la famille, fille et père compris. Le film provoqua alors ce qui fut appelé un bouleversement mystique». Il serait aujourd’hui accablé de tous les noms d’obscénité (…). Génération 68. Tandis que Serge Gainsbourg et Jane Birkin haletaient au bord de l’orgasme «je t’aime moi non plus» et que Bernardo Bertolucci filmait une scène d’agression sexuelle dans Le dernier tango à Paris, David Hamilton entamait sa carrière de photographe de charme. Son fonds de commerce? Les nymphes nues et prépubères filmées dans un flou artistique qui sera alors adopté par la pop culture. L’affaire Dutroux brisera net en 1996 cette période d’anarchie sexuelle et de confusion morale. Aujourd’hui on sait que Polanski demeure accusé pour le viol d’une adolescente, Bertolucci a fait son mea culpa, Hamilton s’est suicidé. Seul Gainsbourg reste encore indéboulonnable mais pour combien de temps encore? On redoute pour bientôt une révision cruelle de sa vie de débauche autour de quelques angles d’attaque: sexe, lolitas, alcool…(…) Car en 2018, l’indulgence vis-à-vis des comportements des artistes a vécu. Un seul slogan 68 demeure d’actualité: «À bas le vieux monde». Fautil préciser que le vieux monde est désormais celui d’il y a 50 ans? Nicolas Crousse, journaliste culturel, extraits d’un article publié dans Le Soir du 21/01/2018
qu’un lointain souvenir. Le monde a changé, la crise s’est durablement installée. Les intégrismes et les combats identitaires ont eu raison des utopies et de l’esprit Flower power. Plus récemment l’affaire Weinstein vient de iffler la fin de la récréation en donnant le sentiment que derrière ses slogans libérateurs («jouissez sans entraves»), la génération 68 participa d’une escroquerie intellectuelle (….) Il y a 50 ans, la Mostra de Venise célébrait le harme vénéneux de Théorème, le film de Pasolini. Une sorte de Christ fait chair entretenait des rapports sexuels avec chaque membre de la famille, fille et père compris. Le film provoqua alors ce qui fut appelé un bouleversement mystique». Il serait aujourd’hui accablé de tous les noms d’obscénité (…). Génération 68. Tandis que Serge Gainsbourg et Jane Birkin haletaient au bord de l’orgasme «je t’aime moi non plus» et que Bernardo Bertolucci filmait une scène d’agression sexuelle dans Le dernier tango à Paris, David Hamilton entamait sa carrière de photographe de charme. Son fonds de commerce? Les nymphes nues et prépubères filmées dans un flou artistique qui sera alors adopté par la pop culture. L’affaire Dutroux brisera net en 1996 cette période d’anarchie sexuelle et de confusion morale. Aujourd’hui on sait que Polanski demeure accusé pour le viol d’une adolescente, Bertolucci a fait son mea culpa, Hamilton s’est suicidé. Seul Gainsbourg reste encore indéboulonnable mais pour combien de temps encore? On redoute pour bientôt une révision cruelle de sa vie de débauche autour de quelques angles d’attaque: sexe, lolitas, alcool…(…) Car en 2018, l’indulgence vis-à-vis des comportements des artistes a vécu. Un seul slogan 68 demeure d’actualité: «À bas le vieux monde». Fautil préciser que le vieux monde est désormais celui d’il y a 50 ans? Nicolas Crousse, journaliste culturel, extraits d’un article publié dans Le Soir du 21/01/2018