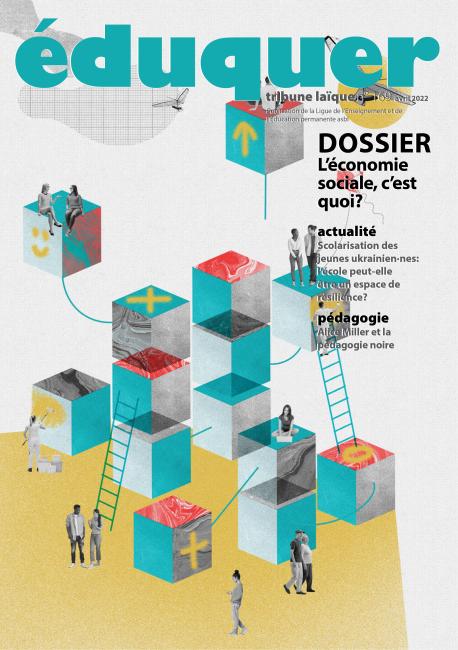Scolarisation des jeunes ukrainien·nes / L’école peut-elle être un espace de résilience?
Mardi 19 avril 2022

Dans quelles conditions la Belgique est-elle aujourd’hui capable d’accueillir les jeunes réfugié·es ukrainien·nes au sein de ses écoles? Quels sont les dispositifs existants et à quelles difficultés externes et limites internes sont-ils confrontés?
Dans le cadre de la guerre menée par le gouvernement russe en Ukraine, les écoles belges doivent s’organiser pour permettre l’accueil des jeunes réfugié·es ukrainien·nes au sein du système scolaire. À ce stade, plusieurs milliers d’élèves seraient attendus. Par le biais d’une circulaire datant du 10 mars, Caroline Désir (PS) revient sur le mode opératoire du dispositif prévu pour l’accueil des étudiant·es primo-arrivant·es en cours d’année scolaire, le DASPA. Elle explique qu’une réflexion est menée pour permettre des inscriptions en dehors de ce dispositif. «Cent trente élèves (originaires d’Ukraine) sont inscrits à ce jour (dans une école de la Fédération Wallonie-Bruxelles), mais cela devrait augmenter très vite et très très fort», a commenté la ministre de l’Éducation, en commission du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La ministre a convoqué jeudi 17 mars une nouvelle réunion avec les pouvoirs organisateurs de l’enseignement, les syndicats et les autres acteurs de l’école pour évoquer cet accueil d’enfants ukrainiens en classe. «On doit se préparer à une arrivée plus massive et sur la durée», a-t-elle ajouté. Si le gouvernement belge doit s’occuper de mener des actions urgentes d’accueil en termes de logement par exemple, elle doit aussi préparer l’accueil scolaire des enfants et adolescent·es. À la mi-mars, «on sait qu’environ dix mille personnes sont inscrites à l’office des étrangers et la moitié sont mineures, et l’on s’attend donc à ce que de très nombreux enfants s’inscrivent dans nos écoles», confie-t-elle. La circulaire traite largement du dispositif DASPA, mis en place en 2012 côté francophone. Elle doit se prolonger par un webinaire prévu fin mars à destination des écoles et des PMS.

Vers une augmentation et un élargissement des dispositifs DASPA
La création du DASPA répond à la condition suivante: que l’école qui sollicite le dispositif ou l’augmentation des moyens qui y sont liés soit confrontée à «une augmentation exceptionnelle du nombre de primo-arrivants ou assimilés aux primo-arrivants en cours d’année scolaire». Pour l’instant, cette augmentation «exceptionnelle» est fixée à huit élèves par école. Soit les écoles bénéficient déjà du dispositif comme c’est le cas de 104 écoles fondamentales et 67 écoles secondaires en FWB: dans ce cas, elles peuvent demander une augmentation de l’encadrement DASPA. Soit elles n’en bénéficient pas: elles pourront alors en faire la demande dès qu’elles atteignent le seuil «d’augmentation exceptionnelle» prévu par le décret. Directrice du S2J à Liège, Antonia Hicter s’est considérablement investie dans le développement du dispositif DASPA de son établissement: «Cela fonctionne plutôt bien, on a une grosse cinquantaine d’élèves répartis entre les quatre classes. Cette année, on a fait appel à la conseillère pédagogique pour réorganiser et penser les choses de manière structurée, pour que cela puisse être un investissement durable. J’ai essayé de mettre en place une équipe assez stable, parce que je me rendais compte que la diversité des intervenants pouvait complexifier la prise en charge des élèves qui ont énormément besoin de repères, d’où qu’ils viennent et quelle que soit leur situation d’origine. On travaille avec une équipe à qui j’ai demandé de postuler, les professeurs sont donc volontaires pour venir travailler dans les classes de DASPA. Ils sont investis dans des formations spécifiques au DASPA». D’après elle, une «coordination spécifique» est indispensable: «l’accompagnement par la conseillère pédagogique est très important car elle renvoie vers des connaissances qu’on n’a pas encore, elle connait les réalités ailleurs, on peut donc aussi profiter de ces expériences-là. On a des jeunes qui vivent des choses terribles et on n’a pas toujours conscience non plus de nos actions, de ce qu’on leur demande et de ce à quoi on les confronte. Ce qui peut parfois être interprété comme un comportement inapproprié de leur part est parfois simplement une manière de se défendre face à des choses qui nous échappent de tellement loin. Pour cela, je pense qu’on n’est pas suffisamment armé·es. Mais on y travaille aussi chez nous, on s’est mis en contact avec une maison de jeunes, qui propose pas mal de formations. On met en place pas mal de choses, mais c’est vrai qu’il nous manque une formation de base spécifique». Sur ce point, elle est rejointe par Corentin Lorand, membre de l’ASBL La Petite École à Molenbeek, une initiative d’accueil des enfants réfugiés organisant une première acclimatation à la scolarité, avant de rejoindre les dispositifs DASPA. Il insiste sur le fait que les professeur·es peuvent être démuni·es quant à la manière d’encadrer des enfants et des adolescent·es en état post-traumatique: «tous·tes les professionnel·les du secteur vous diront la même chose: à part des atouts personnels ou une sensibilité personnelle, on n’est pas vraiment formé·es à tout le travail qui doit être fait dans ces cas-là». Pour Chloé Joseph, référente éducation chez Fedasil à Rocourt, «il faudrait une collaboration plus étroite entre le milieu associatif et les écoles, c’est primordial. Au centre, on a pas mal de bénévoles, assurant notamment des suivis individuels avec les jeunes. L’école est dépassée par l’arrivage, par le fait de ne pas connaitre la vie en centre. Il arrive que les écoles se plaignent de certains élèves, sans être au courant des réalités du terrain. Notre démarche est alors d’aller dans les écoles pour expliquer comment se passe la vie en centre et ce qu’ont fui les jeunes. Ils ont un parcours bien différent et très compliqué, ils sont en survie, ce qui empêche que tout se déroule ‘normalement’. Les profs devraient être formé·es à cela, ou pouvoir venir au centre pour observer, et rencontrer les élèves». Au sein de La Petite École, ce dialogue avec les institutions scolaires fait partie du projet: «La Petite École peut intervenir au sein même des écoles, par exemple, une heure par semaine, pour un élève, dans la classe ou en dehors. C’est assez intéressant, cela permet pour l’élève de créer dans son récit une forme de continuité. Et même s’il n’y a pas d’intervention dans l’école, on reste en contact avec les profs de l’enseignement ordinaire pour suivre comment ça se passe, pour appeler la famille si besoin, pour transmettre un bagage de confiance qui s’est développé avec la famille et avec l’enfant. Les interventions dans les écoles sont intéressantes pour les élèves et pour les profs aussi, parce qu’on soutient autant la famille, le prof, que l’enfant».

La question de la langue
Dans le cadre du DASPA, une des plus grandes difficultés réside dans le manque d’interprètes associé·es aux processus de scolarisation, quand la communication est décrite par tous les professionnel·les du secteur comme un élément-clé de la possibilité et de la réussite d’un projet scolaire. En rendant la communication possible entre différentes langues, il est notamment permis aux parents de s’impliquer réellement dans la vie scolaire de leurs enfants. «Au sein de la Petite École, on a systématiquement des interprètes. Parce qu’on prend le temps et qu’on a moins d’enfants, on peut se permettre d’avoir des réunions de parents systématiquement dans la langue du parent. Ce qui est essentiel, car une confiance s’établit entre les deux parties. Ce n’est pas suffisant mais c’est nécessaire», explique Corentin Lorand. Cela évite de charger l’enfant en le rendant «interprète», «un rôle d’adulte, dans lequel il ne peut plus être l’enfant». C’est en effet la situation décrite par Malak, 13 ans, originaire de Palestine et ayant fui le Liban avec ses parents à l’âge de 9 ans: «au début, à l’école, j’avais un peu peur parce que je n’avais pas l’habitude, mais j’avais confiance, je savais que j’allais m’habituer. Mon papa et ma maman ne comprenaient pas toujours ce que je faisais à l’école. J’essayais de leur expliquer, mais il y a des choses que je comprends en français et que je n’arrivais pas à traduire en arabe». Même constat chez Antonia Hicter: «Audelà du soutien du PMS, de celui que l’école peut apporter, et que ce soit dans les cas des ukrainien·nes ou si on élargit, il faudrait absolument être entourés de personnes qui parlent la langue des jeunes. Il nous en manque beaucoup. On n’a pas accès à certaines informations à cause de cela. Ici, si on doit prévoir quelque chose pour l’arrivée des enfants ukrainien·nes, il faut des personnes qui nous assurent que ces enfants vont être compris. Parce que tout passe au début par la communication. C’est indispensable pour aider correctement le jeune. Un élève blessé, par exemple, dont on interprète le comportement comme de l’agressivité, aurait peut-être envie de nous expliquer qu’il a vu quelque chose de terrible et que ça réveille d’autres choses». Elle ajoute: «quand les parents comprennent moins bien le français que leurs enfants, c’est très compliqué. C’est dur de se mettre en projet ensemble. On y arrive, mais ça mobilise une énergie qui pourrait être mise dans autre chose. La tâche de traduction revient sur l’élève, ce qui peut lui créer un stress. Et pour les parents, c’est difficile: comment prendre sa place au sein d’une scolarité quand on n’arrive pas à être en relation à cause de la langue?»
Un accompagnement psychologique indispensable
Outre la scolarisation, le gouvernement évoque, par le biais de sa circulaire, la question de la prise en charge des traumatismes liés à la guerre et à l’exil. Dans le cadre scolaire, ce sont avant tout les CPMS qui sont missionnés par le gouvernement sur ce terrain. «La prise en charge de cette détresse psychologique ne peut pas reposer exclusivement sur l’école et nécessitera une prise en charge par plusieurs types d’intervenants», précise toutefois la ministre Caroline Désir. Pour Corentin Lorand, il est crucial de comprendre que les personnes réfugiées arrivent «dans un état de survie», dont il faut bien mesurer les enjeux, puisqu’il affecte directement les capacités d’apprentissage des personnes concernées. «C’est parfois difficile à entendre dans nos cultures, mais l’école n’est pas la chose la plus importante au monde, c’est déterminant de le comprendre dans le cadre d’une intégration scolaire avec des personnes qui sont encore en état de survie. Un état de survie, c’est-à-dire où les questions urgentes sont de se maintenir, manger, se loger. Ce n’est qu’après cela qu’il peut y avoir une scolarisation» explique-t-il. Malak raconte: «quand on est arrivés dans notre appartement, j’étais un peu fatiguée mais je disais à mon papa que je voulais aller à l’école sinon j’allais m’ennuyer, et puis je me suis fait très vite des amis». Si le besoin de scolarisation s’exprime au départ, d’après Corentin Lorand, «c’est d’abord un besoin de socialisation, de semblant de vie normale, au-delà de l’école». Les situations d’urgence comme l’exil nécessitent d’abord de réinstaller progressivement un sentiment de sécurité et des repères. L’école, par le biais de son dispositif DASPA notamment, devra donc jouer un rôle d’équilibriste: tout en maintenant in fine le processus d’éducation chez les jeunes, elle doit aussi trouver le moyen de respecter le rythme lent de la restauration de leurs capacités psychiques, émotionnelles et sociales, sans quoi l’apprentissage peut être vécu comme violent et donner une sensation d’échec. Pour Corentin Lorand, les DASPA partent avec un «handicap qui n’est ni leur faute, ni celle des profs, c’est que le cadre scolaire n’est pas forcément le plus rassurant. Il faut prendre du temps pour faire du thérapeutique, et prendre conscience que l’enfant ne va pas tout de suite se lancer dans l’apprentissage parce qu’il a besoin de jouer, de se poser, de trouver un terrain d’entente entre sa vie de famille et sa vie en Belgique, avec des autres codes», ajoute-t-il. Il conseille aux encadrant·es de «penser le lieu de l’école pour le rendre sécurisant et accueillant, et de respecter cet état de survie: il faut être agent de résilience comme on peut l’être, ça veut donc dire ne pas se noyer sous des objectifs d’apprentissage». Les enfants en état post-traumatique sont rassurés par une gestion claire de l’espace et du temps: il peut s’agir de rituels d’entrée et de sortie, de manière «à répéter systématiquement la même journée, qu’il n’y ait rien d’imprévisible pour ces enfants qui puisse les remettre dans une situation de peur, dans la mesure où tout est déjà imprévisible pour eux». Le recours au jeu, par ailleurs, est essentiel et fait partie intégrante du processus de reconstruction chez les jeunes: «je ne sais pas si l’état de survie ‘adultifie’, mais en tous cas, on sait qu’un état post-traumatique bloque l’imaginaire, or le jeu va permettre de le réouvrir un peu. Il faut proposer le jeu et il faut jouer avec eux. En sachant qu’il y a peut-être des enfants qui ne voudront pas jouer parce qu’ils n’y arriveront pas. Cela peut aussi passer par la peinture, le travail de la matière, de l’eau, de la terre, du bois… Tous ces travaux répétitifs qui permettent un peu d’évacuer», estime Corentin Lorand. Reste à savoir si les centres PMS seront à même de jouer leur rôle de soutien psychologique pour les élèves réfugiés, mandatés au niveau institutionnel, et sollicités par des professeur·es qui expliquent n’avoir ni le temps ni les outils pour réaliser ce travail. «On ne va pas se mentir, pour les centres PMS, c’est compliqué, parce qu’ils sont à un moment de l’année où leur charge de travail est énorme, ils n’ont pas forcément assez de temps disponible», analyse Corentin Lorand. Antonia Hicter, de son côté, se dit «très consciente» de la nécessité d’un soutien psychologique pour les élèves en milieu DASPA, et favorise tant que possible l’action du centre PMS de son établissement. Elle rejoint toutefois ce constat: «il faut absolument des ressources extérieures en termes d’aide psychologique, elles ne sont pas suffisantes; les centres PMS sont plein de personnes compétentes mais manquent de moyens».
Face à des besoins qui s’annoncent importants, la ministre Caroline Désir a indiqué envisager d’embaucher des enseignant·es ukrainien·nes, également réfugié·es en Belgique, pour venir prêter main forte. Un groupe de travail spécifique a d’ailleurs été constitué à cet effet.
La majorité des inscriptions attendues après les vacances de Pâques
Si ces informations destinées «à faire face aux premières urgences» pourront être complétées «en fonction des décisions que le gouvernement prendra sur base de l’évolution de la situation et des besoins de terrain», une question reste en suspens: au vu de la pénurie d’enseignant·es, comment la Fédération Wallonie-Bruxelles sera-t-elle capable d’accueillir tous·tes les jeunes réfugié·es dans ses écoles? Face à des besoins qui s’annoncent importants, la ministre Caroline Désir a indiqué envisager d’embaucher des enseignant·es ukrainien·nes, également réfugié·es en Belgique, pour venir prêter main forte. Un groupe de travail spécifique a d’ailleurs été constitué à cet effet. Bernard De Vos, délégué général de la Communauté Française aux Droits de l’Enfant (DGDE,) s’est dit «terriblement inquiet» quant aux conditions de scolarisation des enfants ukrainiens chez nous. «J’ai bien entendu Caroline Désir dire que les DASPA étaient là, mais c’est quand même négliger l’état actuel des DASPA!», a-t-il exprimé. «J’ai beaucoup d’acteurs et d’actrices de ce secteur-là qui viennent me dire: on est complètement débordé·es, on a des classes de 20 (élèves) alors qu’on doit avoir des classes de huit ou dix», a dénoncé le délégué général. «Or, si l’on veut réduire au mieux le risque de trauma psychologique auprès de ces enfants et adolescent·es réfugié·es, il convient de tout faire pour les remettre au plus vite dans la vie sociale, dont l’école», a-t-il encore insisté. Ces craintes semblent largement partagées, tandis que du côté des centres d’accueil la pression ne fait qu’augmenter, les poussant à envoyer leurs jeunes vers des écoles plus éloignées du centre, comme l’explique Chloé Joseph chez Fedasil. «Il va falloir engager des profs pour ces nouveaux dispositifs DASPA, en moment de pénurie, cela va être très compliqué... La solution d’urgence sera d’accueillir ces enfants-là dans les structures existantes et de demander encore aux profs de faire un effort pour accueillir plus d’enfants. Ce n’est pas un problème humainement, mais au niveau de la qualité des apprentissages, cela risque de poser problème», explique Antonia Hicter. La majorité des inscriptions d’élèves ukrainien·nes étant prévues après les vacances de Pâques, de nouvelles propositions gouvernementales devraient suivre, sans doute très attendues par des professeur·es déterminé·es à poursuivre leur mouvement de revendications par le biais d’une nouvelle manifestation dans le courant du mois de mai. Flora Mercié, journaliste
Qu’est-ce que le DASPA?
Depuis le 7 février 2019, un décret est entré en vigueur permettant à une école de faire la demande de création d’un Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et assimilés (DASPA). L’école peut aussi demander l’augmentation de l’encadrement si elle organise déjà ce dispositif. Ce décret a été mis en place pour «faire face à des augmentations exceptionnelles du nombre de primo-arrivants ou assimilés aux primo-arrivants en cours d’année scolaire», d’après les mots de Caroline Désir. Autrefois désigné par l’expression «classes passerelles», le DASPA poursuit un objectif linguistique d’apprentissage du français et de remise à niveau. Son but final est de permettre aux enfants de rejoindre le niveau d’étude qui leur correspond. Actuellement, ce dispositif scolarise 4000 enfants et adolescent·es en Belgique. Suite à l’arrivée des personnes primo-arrivantes en provenance d’Ukraine, la ministre de l’Éducation envisage d’apporter des «modifications temporaires» visant «une plus grande fluidité de certaines procédures et l’octroi des périodes dans des délais correspondant à la réalité des besoins». Si l’inscription des élèves ukrainien·nes se fait en dehors du dispositif DASPA, ils sont alors considérés comme élèves libres. «Des solutions sont actuellement à l’étude pour permettre leur inscription régulière, notamment en réglant la problématique des équivalences et tous les enjeux liés au respect des procédures légales d’inscription en 1re secondaire commune», ajoute Caroline Désir.